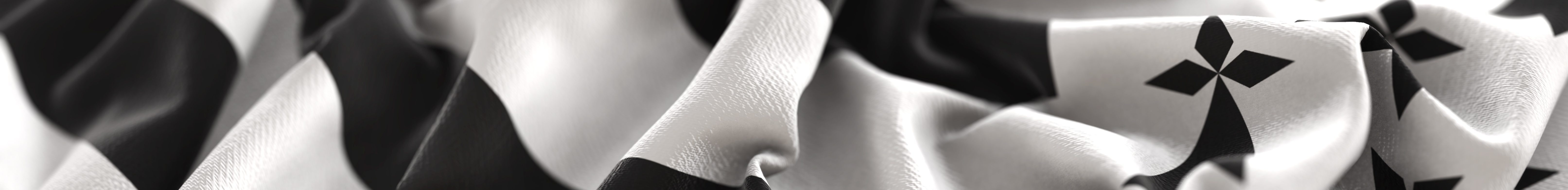Le confinement n’a pas changé grand-chose au mode de fonctionnement de Rover. Pour son troisième album, il s'est enfermé près de 14 mois dans une ancienne glacière à Bruxelles. Pourtant, c’est bien en Bretagne que Timothée Régnier imagine s’installer. Rencontre avec l’artiste et le breton.
 Trois albums en 10 ans… La création est une souffrance ?
Trois albums en 10 ans… La création est une souffrance ?
L’envie est toujours là. Quand je suis dans le process d’écriture, je pense déjà à l’excitation du disque. Toutes les étapes m’excitent. Je n’ai jamais ce sentiment de corvée, de devoir se mettre au travail. C’est même ce que je préfère : l’événement arrive. Je n’ai jamais cette angoisse. En revanche, j’ai une exigence du lieu d’enregistrement. Le lieu remplace l’absence de musiciens, de réalisateurs, de partenaires de jeu.
La composition est très cadrée. Je me pose devant les instruments, je ne réponds plus au téléphone, je ne vois plus les copains… Je vais souvent dans un pays étranger. Ou dans une région que j’aime comme la Bretagne. J’ai ce besoin de me couper du monde. Ce n’est pas de l’égoïsme ou une histoire d’artiste qui a besoin de silence. Non. J’adore la solitude dès lors que j’en vois le terme… La vraie solitude doit être déprimante ! Bref, je me suis enfermé de la composition au mix.
Cette phase d’enfermement a duré combien de temps ?
Sur ce disque, j’ai trouvé un vrai plaisir à laisser filer 4 jours sur une idée. Au total, l’écriture a pris 6 mois. L’enregistrement entre 1 et 2 mois. A la fin, je suis devenu presque addict à ce rythme quotidien. Pour ce disque je suis resté plus d’un an. Presque 14 mois.
Pour votre premier album, vous vous êtes isolé en Bretagne, ici c’est près de Bruxelles dans une ancienne glacière souterraine…
Sur le papier, il n’y a pas plus glauque. J’ai enlevé tout ce qui pouvait divertir. Et effectivement, ce sont les anciennes glacières de Saint-Gilles, un quartier de Bruxelles. C’est un lieu très industriel, très froid, lugubre en apparence. Mon seul plaisir était que je pouvais réunir tous mes instruments dans le même lieu pour avoir la palette de mes outils. Mais, pendant 6 mois, je me suis posé la question : qu’est-ce que je fais là ? Et puis est arrivé un autre problème : l’acoustique. Naïf, je me disais que la réverb’ allait être magnifique pour les chœurs, etc. Sauf qu’on a aussi besoin d’un son très sec pour faire des disques. Et pour trouver l’endroit où ça sonne le mieux, il a fallu du temps. On ne fait pas ça en une semaine. Il m’est arrivé plusieurs fois de tout déménager et tout réinstaller pour redécouvrir le lieu.
Vous dormiez sur place ?
Non, je venais tous les jours à vélo…
Vous avez joué de tous les instruments sur cet album ?
Oui, guitares, claviers, batteries… J’ai aussi fait l’ingénieur du son. Souvent, il y a un ingé son en studio. Là j’ai placé les micros, commandé le matériel… Tout ça a pris du temps. C’est un travail qui va au-delà du simple rôle de musicien. J’assume techniquement ce disque. Il y a une grande liberté.
Et puis, j’ai un amour pour le mellotron. Un instrument inventé dans les années 60. C’est le premier sampler avec des bandes qui se joue comme un clavier. C’était les orchestres de l’époque, on pouvait faire les cordes, les cuivres. C’était de vrais instruments enregistrés. Ça évitait de louer un orchestre. Une manière économique d’avoir des arrangements luxueux. Y’en a plein sur les disques de Bowie, les Beatles évidement… Cet instrument se refait aujourd’hui, j’ai donc pu en avoir en tournée et je l’avais dans mon foutoir. C’est comme ça que j’ai mis du saxophone. Avant je n’y aurait pas forcément pensé. Pour la plupart des gens, c’est anecdotique, mais pour moi, c’est une petite révolution. Comme de garder les premières prises de voix enregistrées la nuit et pas celles du lendemain. C’est ça qui est intéressant. Ça capte quelque chose. C’est quand on s’oublie que c’est intéressant.
 Le regard de l’autre ne vous a pas manqué ?
Le regard de l’autre ne vous a pas manqué ?
Si, ça a été le plus dur. C’est cette barrière là qu’il a fallu accepter : ne plus avoir quelqu’un pour te dire « elle est bonne, on passe à autre chose ». Du coup le lieu te parle, les instruments aussi. Sur les premières interviews pour défendre le disque, je ne voulais pas parler du lieu. Il m’appartient. Mais je ne peux pas y échapper. Je ne peux pas parler des musiciens, il n’y a que moi ! En fait, j’ai besoin du lieu. Pour écrire c’est la même chose. Parfois, c’est à la maison. Ce ne sont pas les mêmes chansons que je sois en Bretagne ou à l’étranger. A Paris, je suis incapable d’écrire une chanson.
Comme les vignes, vous devez souffrir pour donner le meilleur de vous-même ?
C’est possible. Je ne sais pas si c’est une souffrance… Mais il n’y a que dans ces endroits que je parviens à m’oublier. Ce que je ne supporte pas, c’est quand je m’embourgeoise en musique. Quand je sens que je chante bien, que c’est un peu facile, que tout roule… Que ça plait de façon évident. Ça m’angoisse profondément. Chez Lennon, j’aime bien quand il se met en danger, lorsqu’il y a peu d’instruments. Là le disque était quasiment un prétexte pour vivre cette expérience : un homme de 40 ans s’isole en sous-sol dans une ville qui n’est pas la sienne avec des instruments. Ça aurait été un four à pain, j’aurais essayé de cuir le meilleur pain en 14 mois. Après ma fierté, c’est d’avoir été au bout du disque et que ça exprime ce que je vivais. Je ne serais pas malheureux si j’étais charpentier, Il me faut cette démarche quotidienne, il me faut poncer les choses.
 Comment qualifier la pop de votre album ?
Comment qualifier la pop de votre album ?
Je ne souhaitais pas tomber dans le travers d’une pop trop sucrée. Là, le défi c’était de mettre de la lumière. Je ne voulais pas d’une boîte à rythme très froide sur un disque industriel sous prétexte que j’étais entouré de tuyau en aluminium et qu’il faisait 8 degrés. Ma survie artistique passait par une lutte contre tous ces éléments, être le poêle à bois de la pièce. Je n’avais pas de téléphone, pas internet : pas de distraction. Je n’avais que les instruments, comme lorsque j’avais 8 ans et une guitare dans ma chambre. On finit par jouer spontanément. C’est un moyen de se divertir, ça remplace Youtube, ça remplace tout.
Vous vivez encore à Bruxelles ?
J’y passe beaucoup de temps, mais je reste français et résident breton. Mais J’adore cette ville sans y habiter, c’est-à-dire de manière presque clandestine, comme un voyageur. Et d’ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre les bretons et les belges. Ça m’a séduit. Le rapport au temps, aux gens, au stress… Même le rapport aux événements. Un pays à taille humaine qui ne crane pas.
Vous avez des origines bretonnes ?
Oui, du côté de ma mère. Mon père est des Alpes. Et mon grand-père travaillait dans les glacières dans les hautes alpes. Je pense qu’il y a plein d’actes manqués sur ce disque. Et ces glacières existent encore ! Elles sont à l’abandon… Mon père a conservé une petite maison dans un village.
Le quatrième album sera enregistré là-bas ?
Pourquoi pas (rire)
Ou peut-être en Bretagne ?
Il n’y a pas une semaine où je ne pense pas à la Bretagne. Le plus cruel avec le confinement, c’est de ne pas pouvoir m’y rendre régulièrement. Au moins pour voir ma mère ; et la mer. A chaque fois que le panneau « Bretagne » s’affiche avant Vitré quelque chose se passe. C’est bizarre. Enfin à la maison ! Quand je suis en voiture avec quelqu’un, on me prend pour un allumé !
 En quoi votre moitié bretonne influence votre démarche artistique ?
En quoi votre moitié bretonne influence votre démarche artistique ?
Pour avoir vécu en Bretagne après mon retour du Liban, pour le premier disque de Rover, j’ai pu pleinement ressentir les saisons bretonnes. Avant j’étais toujours en vadrouille, même pendant mes études à Rennes. Là j’étais dans les Côtes d’Armor, à comprendre ce qu’était un hiver breton. J’ai pris conscience de l’importance d’être bien chez soi en Bretagne. Et encore je ne suis pas marin ! Je me souviens de tempêtes, de bruits, de courants d’air sous les portes… Je suis d’une famille de citadins qui a voyagé de grandes villes en grandes villes et je fantasmais le jour où je pourrais observer les saisons passées. Et une Bretagne que je ne vivais que pendant les vacances scolaires.
Vous avez cité John Lennon et David Bowie : ce sont les deux artistes phares qui vous inspirent ?
Ils reviennent souvent… Ce n’est pas difficile d’aller puiser du réconfort dans leur musique. Pour John Lennon, il y a une part en moi qui a tant aimé les Beatles lorsque j’étais enfant. John Lennon avait la figure de l’oncle rebelle, cette blessure qu’il avait en lui. On se dit que lorsqu’on a ces blessures en nous, on peut vivre avec. On s’identifie. Il a cette fulgurance, une grâce dont il n’est pas forcément conscient. Ça me l’a rendu très attachant. Mais avec ce disque, je me suis éloigné de ces références, contrairement à mes deux premiers albums. Je l’assume. On a besoin de ça pour se construire. Ce sont deux piliers musicaux. Là, je ne les ai pas écoutés pendant le processus de fabrication. En rentrant à la maison, je n’avais qu’une envie : écouter ce que je venais de produire. Maintenant que mon disque est sorti, je réécoute avec plaisir les nouvelles rééditions de John Lennon.
Vous revoyez les membres des Strokes ?
C’est vrai qu’on jouait au basket ensemble au lycée à New York. J’étais en classe avec le bassiste, la terreur du lycée. De son côté, Julien Casablanca, le chanteur, était très discret. J’ai quitté New York à 14 ans. On ne s’est jamais revu…
Vous retournez à Rennes ?
Oui, j’ai beaucoup d’émotion dès que je retourne à Rennes. C’est une ville qui a compté. J’y ai passé pas mal d’années à essayer de faire des études. J’ai encore des copains en Bretagne à droite, à gauche qui font de la musique. Je sais que j’y finirai mes jours. Près de la mer quoi qu’il en soit. Je sais qu’en Bretagne j’arrive à baisser la garde. Il y a un truc très granitique qui ne la laisse pas violenter par l’extérieur. Ça me plait. J’aime bien les choses ancrées. Elle ne tombe pas facilement sous les effets de mode. On peut encore prendre son temps.
Marquis de Sade est un groupe mythique pour vous ?
Je suis passé à côté. Mais je les ai redécouverts en échangeant avec Dominique A. La génération avant la mienne les cite souvent. J’ai découvert récemment que le chanteur de Marquis est un flamand. Dominique A a vécu à Bruxelles… Je pense qu’il y a vraiment un pont entre la Bretagne et la Belgique. D’ailleurs, ils viennent d’ouvrir une ligne directe Bruxelles – Rennes. Un aller / retour par jour. Enfin !
Vous allez bientôt défendre l’album sur scène ?
Oui, la tournée est déjà bien construite. Elle commence en septembre. On est comme des fous. On sera deux sur scène, Antoine Boissel à la batterie et moi à la guitare. On va être près de l’os, près des chansons, très rugueux, très mobile. A deux, on n’a pas le droit de tricher.
Propos recueillis par Hervé DEVALLAN
Photos : Claude GASSIAN
Rover « Eiskeller » (Cinq 7)