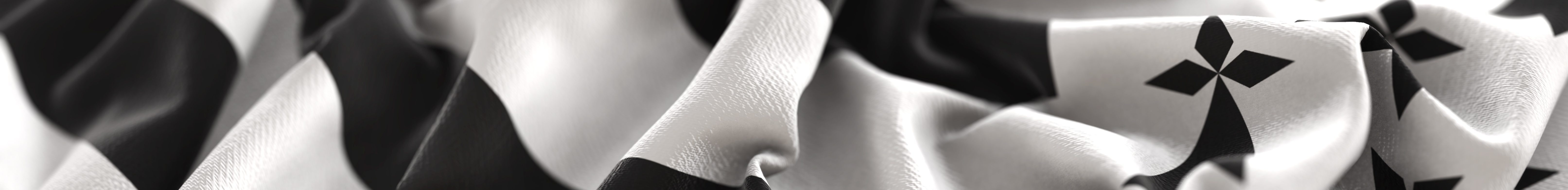Après un EP, sorti en 2016, Why, qui annonçait le meilleur, Frakture, groupe pionnier du punk français, fondé à Rennes en même temps que Marquis de Sade, en 1977, sort un nouvel album en février 2020 prochain, mélodieux et mélancolique. Produit par Dave M. Allen, compagnon de route de The Cure, ou The Sisters of Mercy, So blind to see est un étonnant alliage, mutation d’un groupe culte de la scène underground, ancien laboratoire d’un punk déstructuré, qui se fait moins dissonant, plus mainstream. Sonorités new-wave, accroches punk, mélodies qui restent en tête, textes en français, en anglais et japonais : So blind to see, avec sa forte et originale atmosphère, nous poursuit. La formation rassemble Pierre Thomas à la batterie (ancien de Marquis de Sade et Marc Seberg), Pascal Karels à la guitare (aussi ancien de Marc Seberg), Laureline Prodhomme, nouvelle venue à la basse, autour du leader, chanteur et bassiste, Sergeï Papail. Il nous raconte la naissance et les coulisses de ce superbe disque, dans un entretien au fil duquel on croise les Cure et les Rennais de la grande époque : Etienne Daho, Marquis de Sade, Marc Seberg et Philippe Pascal, disparu le 12 septembre dernier, qui chante en duo avec Sergeï Papail, sur l’un des titres de l’album. Comme une présence essentielle, cœur d’une mythologie, qui subsiste, moderne et éternelle.
 Frakture est un groupe véritablement contemporain de Marquis de Sade. Vous partagez une histoire ?
Frakture est un groupe véritablement contemporain de Marquis de Sade. Vous partagez une histoire ?
Les créations des groupes sont quasi simultanées, en 1977. On est les deux précurseurs. Dès le départ, c’est une histoire commune parce qu’on a emboité le pas du mouvement punk anglais en France et on fait partie des premiers groupes punk français.
Ensuite, il y a eu des croisements. Parce qu’à l’époque, s’inscrire dans un mouvement qui était quand même très en marge de ce qui avait été fait jusque-là à Rennes a conduit les uns et les autres à se côtoyer. Il y a donc eu des échanges d’instrumentistes mais aussi d’influences, d’appétences. C’est comme ça que je suis entré dans Marquis de Sade (en 1978-79). Je suis parti ensuite -je ne me suis pas fait viré, je suis un des rares (rires)- et j’ai remonté Frakture mais avec ce qui m’avait nourri dans Marquis de sade, avec des choses que j’ai apprises et découvertes avec Philippe Pascal. C’est lui qui m’a emmené sur une voie essentielle. Et avec Marc Seberg (groupe fondé par Philippe Pascal en 1981, après la séparation de Marquis de Sade), ça a été la même chose.
Quelle est cette voie ?
Tout cela est né lors d’échanges personnels. A l’époque de Marquis de Sade, on partait tous les deux dans sa maison à Dol, on s’enfermait pendant 3-4 jours. On avait une réflexion sur l’art en général et sur le fait que la musique n’est pas isolée des autres formes d’expression artistique. On était l’un et l’autre à l’époque sur un terrain tout neuf et on n’avait pas d’expérience de la musique. C’est ‘tombé’ sur la musique mais ça aurait pu être la peinture, la sculpture, le cinéma… Je ne me suis jamais vraiment considéré comme un musicien et Philippe Pascal non plus. Ce n’était pas un instrumentiste d’ailleurs mais quelqu’un qui travaillait par rapport à ses émotions, qui les transcrivait. La musique était le vecteur. Il m’a fait découvrir les peintres et le cinéma expressionnistes allemands, que je ne connaissais pas et il y a eu cette osmose. Je dois tout à Philippe Pascal. Absolument tout. Artistiquement, s’il n’avait pas été là, je ne sais pas si j’aurais continué à faire de la musique. Je pense qu’on avait cette connivence artistique même si on a fait, chacun de notre côté, des choses très différentes.
Ce qui frappe d’emblée dans So blind to see, c’est le côté très accessible de l’ensemble, qui n’a rien à voir avec la déstructuration du Frakture des années 70. Tu voulais sortir d’un côté expérimental ?
Cet album est plus mainstream. L’EP était déjà comme ça, avec des structures plus simples et tournées vers les harmonies vocales. Mais ce qui a surtout refaçonné l’album c’est le travail avec Dave Allen (David M. Allen, producteur de The Cure, The Sisters of Mercy, The Human League…), en Angleterre. Dès lors qu’il m’a dit que ça lui plaisait et qu’il acceptait de travailler sur la production de l’album, et pas uniquement le mixage, ça a changé beaucoup de choses. Cet environnement plus accessible émane aussi des volontés de Dave Allen qui nous a donné une feuille de route avant d’aller travailler sur la production en Angleterre. Il s’est vraiment inscrit dans la production en nous donnant sa vision des choses. On a refait des guitares, des voix. Il a choisi l’ordre de l’album. Frakture est le premier groupe français qu’il produit.
Comment qualifies-tu le son de Dave Allen ?
Si je voulais simplifier les choses, je dirais que c’est le son des Cure. C’est lui qui a façonné leur son même s’il n’a pas toujours été leur producteur. Il y a une sorte de spatialité indéfinissable. Dave Allen a ce génie d’utiliser peu d’éléments de production mais en sachant les mettre en avant. Les Cure, c’est l’exemple type d’un groupe qui utilise peu de choses, peu d’arrangements. On tire la quintessence de ce qui existe déjà.
Ce côté mainstream est aussi une volonté de ta part ?
On ne s’est jamais dit qu’on voulait faire un album qui sonnerait comme ça. Je pense que si tu fais ça, tu vas dans le mur. Ça n’est que le fruit d’une évolution, d’un enrichissement artistique. La musique de Frakture est basée énormément sur le texte. Ce que je raconte emmène la musique quelque part et je ne suis plus dans la logique de déstructuration qu’on avait à l’époque des débuts de Frakture. Elle répondait directement, avec une forme de constat, voire de provocation, à ce qui existait à l’époque : le mur de Berlin, l’Union soviétique, cette froideur de la guerre froide. Aujourd’hui, la guerre est toujours là mais il s’agit davantage de terrorisme, une guerre latente, permanente, qui peut frapper tout le monde à tout moment. On est pétri par ces nouvelles formes de violences qu’on ne traduit pas par des formes fracturées, brutales, comme on le faisait à l’époque, mais davantage par l’émotion et la mélancolie. On en avait parlé avec Dave Allen : je lui avais demandé comment il qualifiait notre musique. Il m’avait répondu « triste et mélancolique, dark pop ». Il touchait juste.
On sent de façon claire l’influence de la new-wave plus que du punk. Sur certains titres les Cure ne sont pas loin.
Oui. Mais parce que Dave (Allen) est très présent. Effectivement, y a une influence new-wave. Et en même temps, la new-wave n’est que le développement artistique et beaucoup plus réfléchi du mouvement punk. Il a cassé des standards mais a aussi emmené les artistes sur une voie de plus grande liberté. L’after-punk s’est transformé en new-wave. Il y a des connexions évidentes.
Mais sur la forme, le changement est grand entre les Frakture de 1977 et de 2019.
Il y a un énorme changement. Mais je ne me suis pas levé un matin en disant ‘il faut faire quelque chose de différent’ en reniant le passé. On ne renie pas le passé, on ne le ressasse pas non plus. Tout a évolué, nous aussi ; on a vieilli, on joue mieux qu’avant… Mais effectivement, c’est radicalement différent.
Chanter en allemand était politique dans les années 70. Tu chantes aujourd’hui en français parce que c’est naturel ?
Ça l’est devenu, oui. Les structures de new-wave, de rock, sont très difficiles pour poser du français. C’était aussi une manière de lever le voile d’une certaine pudeur. Chanter dans une autre langue a un côté pudique : un Français pourra le comprendre mais pas au premier abord, donc on se cache un peu. Il s’agissait de sortir de cette pudeur et de faire partager des choses plus intimistes et poétiques, liées à l’amour et aux souffrances qui y sont liées, au regret.
Mais surtout, Etienne Daho a eu beaucoup d’influence sur cette manière pour moi d’aller vers le français. On en a parlé ensemble. Il aimait bien l’EP qu’on avait fait et il m’avait dit qu’il fallait franchir le pas. Il m’avait dit qu’on pouvait tout se permettre aujourd’hui et même mélanger les langues. Et c’est ce que je fais sur deux morceaux, Lost in heaven et Geisha Noises. On n’a pas travaillé ensemble mais le fait d’échanger a participé à mon travail sur l’album.
Tu as une proximité artistique avec Daho ?
A titre personnel, j’apprécie son travail : il est d’une grande intégrité artistique et il est capable de traverser le temps en faisant évoluer son univers tout en conservant sa ligne très personnelle.
Tu dirais qu’il y a un style rennais chez Frakture, encore présent dans So blind to see ?
Je ne crois pas. On reste rennais. Je ne renierai jamais mes racines. C’est grâce à elles qu’on fait cet album aujourd’hui. Sans Rennes, sans Philippe Pascal, je ne ferais pas ça maintenant. Mais en passant le Channel (la Manche) et en allant travailler avec Dave Allen et des Anglais, Frakture n’est plus un groupe rennais. On a une production 100% anglosaxonne.
Le groupe travaille de la même manière qu’avant ?
Oui. On est quatre maintenant. Laureline (Prodhomme) est parfaitement intégrée. Je voulais avoir une part de liberté sur scène, le chant étant beaucoup plus exigeant, Avec une deuxième bassiste, on peut aussi échanger et compléter les jeux.
Et ça permet de bien exploiter le travail de Dave Allen. En plus, une fille change beaucoup de choses dans le travail de groupe : elle enfouit un peu les égos surdimensionnés des mecs, elle pose un regard plus doux, avec plus de recul… Et elle chante aussi avec moi.
On garde une logique de travail de groupe. Si Pierre (Thomas, batteur) n’avait pas posé un rythme tel que celui-là sur le morceau Flies, il n’existerait pas comme ça. Mais, d’une façon générale, j’apporte 80% des lignes mélodiques et Karels (Pascal Karels, guitariste), mon binôme, ma connexion artistique permanente, apporte au final le morceau. La musique de Frakture n’existe pas sans Karels et sans moi. C’était déjà ça à l’époque.
Vous avez le projet de faire beaucoup de concerts ?
C’est l’objectif. On joue à Tournai, en Belgique, le 9 novembre, au festival Question of wave, avec le groupe belge The Names. Mais le disque ne sortira qu’en février. Avant, on tournera un clip. Richard Dumas s’occupe de l’artwork de l’album. La première photo de sa carrière pour la pochette d’un album était pour Frakture à nos débuts !
Tu te sens nostalgique de cette époque ?
Non. Je me dis très souvent que j’ai eu cette chance de vivre à cette période, en vivant les mêmes choses que des gens comme Etienne Daho. J’ai une sorte de fierté d’avoir participé à ce mouvement incroyable qui a marqué l’histoire de la musique en France. Mais ce n’est pas de la nostalgie. Cette connexion artistique incroyable nous a amenés à faire ce qu’on réalise maintenant. Avec la chance de travailler aujourd’hui avec Dave Allen. Je n’aurais jamais cru autrefois qu’un seul de mes morceaux serait produit par le producteur de The Cure.
La disparition de Philippe Pascal sonne la fin d’une époque ?
C’est un livre qui se ferme mais sur lequel on aura toujours la main posée. Qu’on pourra ouvrir et reparcourir toujours avec beaucoup de bonheur. Je repense à la chanson I am a book (I neither wrote nor read) (texte de Delmore Schwartz, mentor de Lou Reed) dans laquelle sa voix est superbe. C’est la fin de quelque chose mais qui reste toujours très présent.
Propos recueillis par Grégoire LAVILLE
Photos Maiwenn LE FOULER
A lire aussi : interview de Pascale Le Berre
A lire aussi l’interview de Philippe Pascal