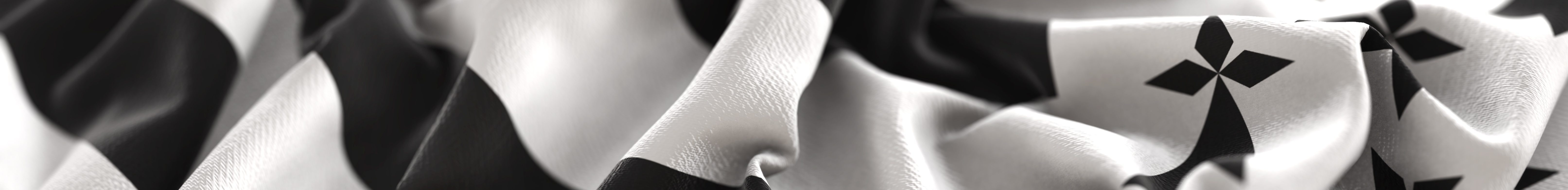L’écrivain anglais Richard Jefferies (1848-1887) demeure largement méconnu. En rééditant son livre majeur, L’histoire de mon cœur, les éditions Arfuyen jettent un coup de projecteur sur un auteur dont les propos prennent – en ces temps de dérèglements de toute nature – une résonance particulière.

On a souvent comparé Jefferies à Thoreau. Chez l’auteur anglais comme chez l’auteur américain, il y a le même amour de la nature et le rejet foncier des modes de vie induits par la société industrielle naissante. Henry David Thoreau déambulait dans la campagne et les forêts du Massachusetts. Richard Jefferies apprécie les longues balades méditatives dans les collines de son comté natal, celui de Wiltshire, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Autour de lui, « les champs heureux », « les jeunes coucous », « les bois pentus », « les ormes gracieux », « les buissons d’aubépines et de noisetiers »… Il le dit : « Je respirais l’existence à pleins poumons » (…) « J’étais absolument seul avec le soleil et la terre ». Allongé dans l’herbe, il regarde les grands nuages qui viennent de la mer. « L’herbe soyeuse soupire lorsque le vent arrive, portant le papillon bleu plus rapidement que ses ailes ne le peuvent ». Et quand il se rend au bord de la mer, il s’empresse de plonger dans la grande bleue. « Je nageais, et qu’est-il de plus délicieux que la nage ? Elle concilie l’exercice et le raffinement ».
Autant la nature le subjugue et l’envoûte, autant la civilisation moderne, notamment son côté grégaire, suscite ses critiques. « Le spectacle le plus renversant, selon moi, est le grand gaspillage de travail et de temps, dépensés tout simplement pour subsister ». Quand il doit se rendre à Londres, il fuit « la foule, son bavardage incessant et décousu ». Pour lui la foule est un « tourbillon » et la « pensée en est absente ». Ce qu’il dénonce foncièrement : « Une morale fondée uniquement sur l’argent ». Cette détestation des normes de son époque l’amène à manifester une forme de haine, voire de violence contre ce monde « si violemment attaché à son étroit sillon égotique, si stupide et si content de soi sous l’immense poids de la misère ».
Mais au-delà de cette opposition entre une nature bienfaisante et une civilisation oppressante, il y a chez Jefferies une profonde quête spirituelle (en dehors de religions instituées) qui l’amène à formuler ce qu’il appelle « la 4e idée ». Il s’explique : « Trois choses seulement ont été découvertes en matière de consciences intérieure ». Et il cite « l’existence de l’âme, l’immortalité, la divinité ». Son ambition est de pouvoir « avancer plus en avant et arracher un quatrième élément et, peut-être même, encore plus qu’un quatrième, à l’obscurité de la pensée » et « en savoir plus sur la vie de l’âme ».
Ce questionnement d’ordre métaphysique se double d’une approche des notions de vie éternelle et d’éternité. « C’est maintenant qu’est l’éternité », écrit-il. Il n’en finit pas de faire l’éloge du « merveilleux présent ». Pas éloigné en cela des expériences spirituelles d’Extrême-Orient. Jefferies avait lu Confucius, dont il retient notamment « la voie sans effort ». Le taoïsme ne lui est pas inconnu. Il avait dans sa bibliothèque le Bhagavad Gita. Autant de marqueurs qui font étonnamment penser à la démarche d’un Herman Hesse au 20e siècle, y compris sur le thème de l’oisiveté chère à l’écrivain allemand. Richard Jefferies écrit pour sa part : « J’espère que les générations futures auront la possibilité d’être oisives ; j’espère que les neuf dixièmes de leur temps seront consacrés aux loisirs ; qu’elles pourront profiter des journées, de la terre, et de la beauté de ce beau monde ; qu’elles pourront se reposer près de la mer et y rêver ».
Pierre TANGUY
L’histoire de mon cœur, Richard Jefferies, traduit de l’anglais et présenté par Marie-France de Palacio, aux éditions Arfuyen, 220 pages, 17 euros.