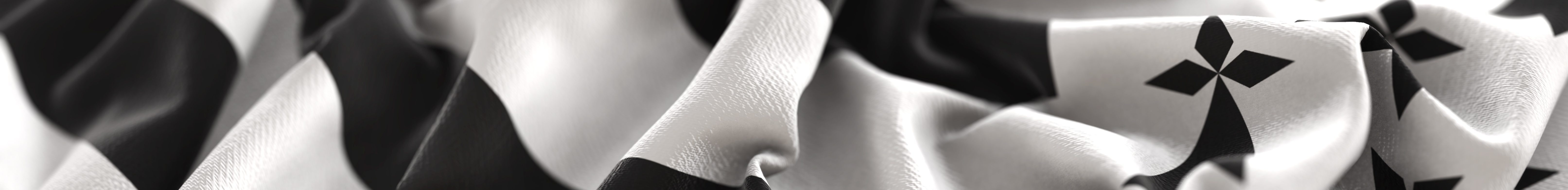Le peintre est né en 1914. Comme on aime les comptes ronds et que les commémorations aident aux regroupements, on fête Nicolas de Staël cette année alors qu’il faudrait le fêter chaque année. Chaque jour est son anniversaire. Chaque jour de ciel et de mouettes, chaque jour de tristesse et d’absolu appel du vide. Chaque jour de regard intérieur et de vis-à-vis du monde.
 Staël nous conduit cette saison du Havre à Antibes. Mais sa route passe partout, dont des aplats épais qui sourdent de la terre. Dont les bitumes bleus ou le vert du ciel, celui des corps qui dansent ou le ballon du Parc des princes. Les ventres de femmes, leurs jambes cylindriques entre gris et bleu métallique, le cône orange des soleils, Staël a cette science du trait à peine déposé qui décide la forme. Profitons du bel été de Staël non sans regarder en face ce qu’il reste de Syrie, les façades trouées d’Irak ou de Lybie ou Gaza qui s’endort sous l’effroi des cadavres.
Staël nous conduit cette saison du Havre à Antibes. Mais sa route passe partout, dont des aplats épais qui sourdent de la terre. Dont les bitumes bleus ou le vert du ciel, celui des corps qui dansent ou le ballon du Parc des princes. Les ventres de femmes, leurs jambes cylindriques entre gris et bleu métallique, le cône orange des soleils, Staël a cette science du trait à peine déposé qui décide la forme. Profitons du bel été de Staël non sans regarder en face ce qu’il reste de Syrie, les façades trouées d’Irak ou de Lybie ou Gaza qui s’endort sous l’effroi des cadavres.
Staël est en même temps au nord et au sud de la France. L’expo du Havre joue de cette double exposition : sombra/sol. Les deux se complètent et font rétrospective. Il faut aller de l’une à l’autre, y revenir si possible alors que lui n’a jamais fait retour. Staël est de Saint- Pétersbourg, prince de naissance et rabroué par l’histoire. Ses tuteurs ont un nom italien, Fricero, ils sont bruxellois : son projet de peindre est un imperium. Je serai peintre, c’est son mot. Ce mot dont on n’est pas si sûr qu’il le prononçât ni qu’il l’écrivît mais qui est d’évidence, entendu en tous sens par les amis, les critiques si incompréhensibles ou les galeristes durs ou consentants à ses changements, ses virages en épingle à cheveux et ses combats avec les lueurs. Staël est pénible à lui-même donc aux autres, dans les hésitations, les rencontres, les chagrins d’amour, le lien avec Concarneau et sa concarnoise Jeannine Guillou, ses voyages, ses retraits. Sa passion est de peindre et toute son existence y est misée.
Passons d’abord par le Havre, ainsi que notre pérégrination. Le Musée Malraux est si beau, si bien placé aussi. Les bateaux passent quasi contre ses vitres qui équivalent à des cimaises. L’accrochage des ciels de Boudin y résume un manifeste normand et Staël, qui est allé à Varengeville chez son ami Braque « le plus grand des peintres vivants de ce monde », loge à l’étage en-dessous. Ses grands formats abreuvent, inondent, submergent : la Manche au dehors est pâle de jalousie et l’estuaire de la Seine se sent un destin de copie. Le Musée Malraux se visite en ce moment comme on pénètre une église. Les saints sont de Staël, laïques absolument, les ex-voto de Staël, immenses, les vitraux de lui aussi, dans les chapelles, l’ébloui, c’est lui : Agrigente magnétise, ses couleurs nous traversent. C’est vers Agrigente que les fidèles vont ! Le regardeur s’y noie. Les couleurs prennent possession de tout de nous comme elles l’ont possédé lui.
Il est possible que d’autres s’arrêtent en plein vol d’une mouette, lourd et sourd, ce pli immense qui se déplie. Cette douleur des couleurs que Staël va chercher. Nous qui sommes devant, restons scotchés, comme on dit maintenant.
Possible, à Antibes, de trouver dans l’immense forme du nu le même pli que celui de la mouette susnommée. C’est vrai. Le nu emporte, le bleu est ici quand le gris est là-haut. Le rouge du nu d’Antibes fait un fond insondable et le corps allongé avec ses pinceaux pour dire les coups que produit un corps de femme allongé sur la lumière. Staël est sous la double emprise des formes et de la lumière. Alors, le trait décide, le V s’élargit, c’est un ventre ou c’est une aile d’oiseau de mer qui s’ouvre, un sexe qui foudroie. L’ange passe. Peu importe la figuration, puisqu’elle est abstraite : la réalité se soustrait au peintre comme elle échappe à ceux qui ne peignent pas.
Staël est l’homme qui peint.
Il nous convoque dans le tableau. Pas seulement façon de le dire. Les couleurs nous racontent autre chose que les couleurs. Le bord des traits est une sorte de ligne entre soi et l’absolu. Là que réside peut-être, juste sur le bougé de cette ligne, le sacré.
Référons un instant à Emmanuel Levinas : ce tremblé du presque. Staël peint presque la ligne, à peu près le tremblé entre figuration et abstraction, ce qu’on voit entre.
Qu’on retrouve encore plus finement montré en filant plein sud, mille et quelques kilomètres depuis le Havre jusqu’Antibes. Est-ce que c’est parce qu’au Musée Picasso, sur les remparts face au large, ici si bleu, si vaste où même les yachts des super-riches apparaissent de pacotille, dérisoires. Au moins, au Havre, les porte-conteneurs ou les supertankers qui passent font des tableaux mobiles, ils avancent en touches oranges ou bleue, couleurs primaires comme des palettes à l’allure de géant. Les vraquiers sont des peintures qui passent quand, à Antibes, le bleu est parsemé de bling et de bling. Juste à côté du Musée, c’était l’heure de la messe, dans la jolie église dont l’abside tourne le dos à la mer. On se disait qu’une église, on ne se rend pas compte, à la voir si quiète et lumineuse à midi, on ne peut imaginer ce qui se passe dedans, l’eucharistie, l’incarnation ou les chants, comme dans le corps d’une femme, on ne sent pas ce qui s’y déroule, les changements d’humeur, les pensées ou le fol étirement des rêves. Dans un tableau de Staël, si, à peu près.
Le tableau de Staël montre à la fois ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, tente et souvent y parvient.
On voit le dessus et le dessous. On voit les épaisseurs, les restes blancs de la toile, ses tissages, sa fibre. On voit la transparence de la couleur ou sa force brute, l’ondoiement des couleurs rejoignant les yeux des spectateurs. Le tableau de Staël est une radiographie de l’âme.
Au château Grimaldi d’Antibes, peut-être parce qu’on y est cueilli par l’ultime tableau, l’œuvre inachevée, ce grand fond rouge où l’on s’abîme parce que Staël s’y est abîmé, peut-être à cause de cet accueil que nous entrons directement dans le silence vivant du sacré (pour cette raison qu’un instant auparavant, en préface, la cathèdre voisine nous a obsédé !). À notre arrivée, donc, le tableau immense du concert. Un concert dont le chef est parti, a jeté sa baguette dans l’abîme. Restent la contrebasse et le piano dont les touches évitent de ressembler à des dents. On est accueilli par ce tableau au format considérable dont on sait qu’il ne sera jamais signé des cinq lettres fines, scriptes et séparées, on le sait, cela nous obsède car, avant de rentrer dans le musée, on a vu la maison fatale, l’atelier où le vide a appelé le vide. Juste à côté, sur le même rempart, à quelques mètres, au-dessus de la même immensité des eaux, face aux mêmes scintillements, on le sait, on le sent, que Staël s’est jeté à deux pas d’ici dans l’incroyable toile du noir.
Les peintures de Staël sont puissantes parce que passionnelles. Elles disent cette passion du vide en ne le (et en ne la) saturant pas. Nicolas de Staël a eu comme Camus le goût du foot. Celui du mouvement des footballeurs, les couleurs de leurs maillots, la clameur de leurs jambes, c’est du vide à peine rempli. Le mouvement empêche la saturation, comme la danse, comme le foot, comme la musique ou le battement des ailes. La vibration s’avère une matière que le peintre édulcore, cherche, par moment, sans l’arrêter. Il peint parce qu’il vibre.
Les dessins présentés à Antibes disent encore mieux cette dialectique du vide qui vibre. Ce seul trait pour un visage, un seul trait. Un coup de crayon. Allez-y voir, l’incroyable est là. Ou comme ces danseuses qui donnent une idée de cette autre danse du crayon, ce minuscule trait qui souligne l’enroulé de la robe et de l’air qui gonfle le cercle du tissu. Ces esquisses ne sont pas que des préparations : elles disent déjà, comme des manifestes discrets, la nécessité du vu. Staël peint le vu. Les esquisses sont mieux que la danse de la réalité, ce dont Staël se protégeait et d’une certaine manière, lorsqu’on entre dans son dialogue pictural, on ne peut pas ne pas entrer dans une conversation mystique, terrifiante, odieuse, une sorte de conversation entre le plein du vide et le vide du plein. C’est cela qu’il peint.
Il peint ce qu’il a vu, c’est sûr et ce qu’il ne peut plus voir que là, sur l’effort quasi affolé de la toile.
À l’instar de cette route d’Uzès qui a occasionné à Uzès (Gard) une belle conférence, début juillet, avec sa fille Anne de Staël et Jean Pierre Chauvet. La petite ville languedocienne, davantage abonnée aux bonbons Haribo, remplaçants du réglissime Zan, s’est enfin souvenu que Nicolas de Staël avait séjourné à quelques kilomètres d’elle, chez le critique d’art, ami entre autres de Braque et Picasso, Douglas Cooper.
La conférence a drainé deux cent personnes. Salle comble pour la petite ville plutôt encline aux tauromachies de piscines et autres bouvines de pacotille. Deux cents personnes et un petit livre pour une toute jeune maison d’édition La Fenestrelle. Le livre n’en est pas un, plutôt une compilation, un bric à brac littéraire (Lucien Clergue, Chauvet, Anne de Staël y témoignent outre une intro à l’expo d’Arles de 1958 par son commissaire Douglas Cooper) mais nous ne ferons désormais plus sans ce corpus utile à l’histoire staëlienne. Le petit livre intitulé Rencontre sur la Route d’Uzès ne restera pas pour le texte mal écrit d’Anne de Staël (« Une route est un pont suspendu dans l’axe d’un retour sur soi-même sur la trajectoire du fugitif »), ni pour la désinvolture éditoriale envers les conventions de ponctuation mais, (tout cela étant dit pour faire mieux lors d’une réédition !), ces textes rendent compte historiquement et contextuellement des séjours du peintre dans le château de Castille d’Argilliers près d’Uzès qu’occupait à l’époque le collectionneur du cubisme et critique respecté Douglas Cooper. À lire ce document de travail d’autant important que Castille continue de contenir, bétogravé, le fameux Mur de Castille de Picasso, invisible pour l’heure au public.
Staël y a donc peint aussi sa vision du vide. Les neuf Routes d’Uzès sont des chefs d’œuvre comme presque tout de Staël : quatre toiles et cinq études au stylo-feutre. On y tient particulièrement parce que ces triangles de routes, ce point qui converge, tout les pousse au punctum absolutum de l’abstraction. Staël révèle par ce qu’il abstrait. Il montre par ce qu’il retire. Il enlève du paysage pour le rendre insistant, plus réel car réifié, plus problématique car soudain réduit à sa structure. C’est du paysage son épure qu’il donne à voir dans l’espacement du châssis. Cézanne y arrive après plus de quatre-vingt Sainte Victoire, Staël en trois routes touche à cette révélation de l’invisible.
Plus il abstrait et donc, plus il figure. De cette figuration il passe, c’est ici le seuil mystique, à la transfiguration. Le paysage d’Uzès est parfaitement révélé dans sa fibre, peut-on dire dans sa subliminarité, voire dans son essentialité. Staël a peint quatre routes, les autres sont dessinées. On les voit, géographiques et mesurables, lorsqu’on parcourt de Remoulins vers Uzès, la RD 981 qui mène, entre les beaux platanes, sous l’aplat des vignobles ou la courbe des serres l’œil vers ces Cévennes bleus ou blanches que fonde l’horizon : le punctum ! Les quatre tableaux Routes d’Uzès répondent à une structure que la réalité a imposée (et impose encore). Le triangle des formes, la suspension du ciel autant que de la terre, ces angles du chemin, des vignes et des collines coupées de restanques qui font, comme celui dont la mort est au bout, l’assurance même de, juste auparavant, exister : par la preuve du tableau. Après tout, peindre le Fort Carré d’Antibes ou les natures mortes aux alignements de bouteilles, s’y découvre à chaque fois la structure à l’emploi de sa forme : Stael peint l’épure au sens de l’essentiel.
On s’est davantage arrêté sur les routes d’Uzès car c’est d’ici qu’on écrit ces mots. Donc, plus près d’Antibes que du Havre. Le voyage cet été 2014 est staëlien. Les catalogues seront à feuilleter ensuite (très beau, celui d’Antibes car les dessins et autres études s’approchent tout près de l’œil, sans compter le beau texte de Maryline Desbiolles intitulé Ecrire comme un peintre), durant les saisons plus sombres, pour que se recommence sans fin la peinture si puissante, si subtile aussi qui a rendu l’invisible un peu moins.
Gilles CERVERA
Psychanalyste, membre du Comité de Rédaction de Place Publique Rennes
Le Havre : exposition Nicolas de Staël au Musée d’Art Moderne André Malraux jusqu’au 9 novembre.
Tél. : +33 2 35 19 62 62
https://www.muma-lehavre.fr/
Antibes : exposition Staël, la figure à nu 1951-1955 au Musée Picasso jusqu’au 7 septembre
Rencontre sur la Route d’Uzès aux éditions de La Fenestrelle
https://www.editions-fenestrelle.com/