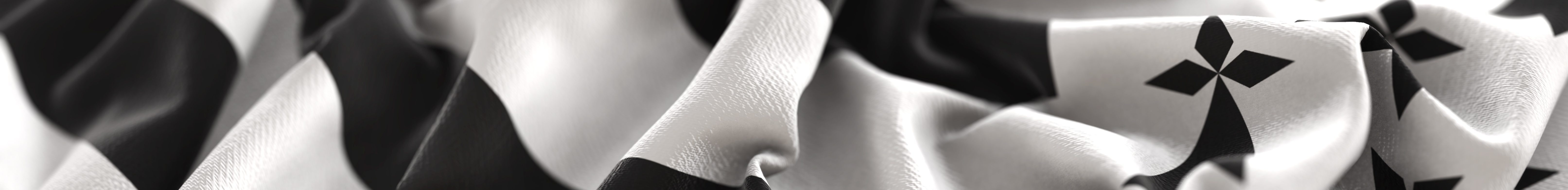Le bio est à la mode. Chaque année il progresse au détriment du marché traditionnel. La production française est toutefois insuffisante pour satisfaire une demande exponentielle. En résulte un bio du bout du monde, énergivore, un bio aux logos trompeurs, venu d’ailleurs, et la Bretagne n’est pas en reste avec le dérapage industrielle du "bio business".
 La France est le troisième grenier de l’agriculture biologique européenne. Le pays traine cependant à suivre l’enthousiasme des consommateurs. Production trop faible, filières insuffisamment structurées, nos quelques 32.000 exploitations certifiées n’y suffisent pas : nous manquons d’œufs, de lait, de viande, de céréales, de fruits et de légumes. Plutôt que d’importer du bio éparpillé au quatre coin du monde, il est urgent d’aider la transition des agriculteurs qui le souhaitent. Mais convertir une ferme demande plusieurs années nécessaires à l’assainissement des sols et au respect d’un nouveau cahier des charges.
La France est le troisième grenier de l’agriculture biologique européenne. Le pays traine cependant à suivre l’enthousiasme des consommateurs. Production trop faible, filières insuffisamment structurées, nos quelques 32.000 exploitations certifiées n’y suffisent pas : nous manquons d’œufs, de lait, de viande, de céréales, de fruits et de légumes. Plutôt que d’importer du bio éparpillé au quatre coin du monde, il est urgent d’aider la transition des agriculteurs qui le souhaitent. Mais convertir une ferme demande plusieurs années nécessaires à l’assainissement des sols et au respect d’un nouveau cahier des charges.
Le bio est avant tout une obligation de moyens et non de résultat
Le label bio européen (la feuille étoilée sur fond vert) ne certifie absolument pas qu’un produit est dénué de cochonneries synthétiques, mais que le producteur a mis en œuvre toutes les conditions pour cultiver sans OGM, sans pesticide ni engrais chimique, et nourrir ses bêtes avec une alimentation (en partie) bio. Il stipule qu’un organisme de certification est venu vérifier le respect de ces règles lors d’un contrôle prévu ou inopiné. Rien de plus. En d’autres termes, le bio est avant tout une obligation de moyens et non de résultat.
Nonobstant ce contrat fort mal (ou jamais) expliqué aux consommateurs, il y a aussi les exemples de produits bio qui n’en sont pas. Lorsqu’on achète un label bio, on pense en effet s’offrir un produit plus vertueux que celui issu du circuit conventionnel. Hélas ! cette promesse n’est pas toujours tenue. Prenons la composition d’un filet de poisson « sauvage » à la basquaise. La préparation (sauce, épice…) est effectivement bio, mais pas le poisson puisqu’il est impossible de « tracer » un animal aquatique sauvage. Peut-être est-il même radioactif. On n’en sait rien ! Au mieux, ce type de produit devrait pouvoir afficher le logo « pêche durable » qui vise notamment à limiter la surpêche, pas davantage. Les préparations à base de poissons sauvages ou d’animaux chassés garantissent seul un assaisonnement bio. La matière première est impossible à certifier.
La mondialisation rend les contrôles quasi inefficaces
Chacun de nous aura en outre constaté que les rayons bio des supermarchés offrent des courgettes et des tomates toute l’année, venues d’Espagne ou d’ailleurs ; mais aussi des bananes dominicaines, des pomelos de Floride, des mangues mexicaines… Au total, 50% de nos fruits bios sont importés. Il y a bien entendu ceux qui ne poussent pas sous nos latitudes, mais aussi et surtout ceux dont-il suffirait d’attendre la saison pour les acheter, au moins par conscience écologique puisque les importations globales de la consommation française (tous secteurs confondus) sont à l’origine de la moitié de l’empreinte carbone hexagonale. Mais de ça, que nenni ! Personne ne parle. Il faut consommer.
Les associations écologistes sérieuses rappellent que le bio doit s’inscrire dans un respect des rythmes saisonniers, tout en favorisant les circuits courts et régionaux. Ce n’est bien entendu plus le cas depuis que la consommation bio engage des produits transformés par l’industrie sans aucune garantie de traçabilité. On se souviendra du faux bio et du vrai scandale italien au début des années 2000, lorsqu’une filière fut démantelée par la police véronaise après avoir écoulé 2.500 tonnes de produits classiques contrefaits. Il s’agissait de farine, de soja, de froment et de fruits secs avec des logos falsifiés et des certificats bidons. Ce trafic entre la Roumanie et l’Italie a duré plusieurs années. Les produits de base étaient achetés via des sociétés écran puis « transformés » discrètement en bio qui n’en était pas, avant d’être revendus à un prix quatre fois supérieur.
Il est urgent d’aider la transition des agriculteurs qui le souhaitent
Plutôt que d’importer du bio éparpillé au quatre coin du monde et, par-là même, prendre le risque d’une dilution des contrôles à chaque frontière, il semble on ne peut plus urgent d’aider la transition des agriculteurs qui le souhaitent. Éventuellement adapter le cahier des charges européens à des exigences locales plus restrictives et paradoxalement moins contraignantes. A ce titre, une soixantaine de paysans bretons spécialisés dans la production de fruits et légumes biologiques, estiment dépendre d’un cahier des charges bruxellois en deçà des exigences qui devraient être requises. Ils ont décidé d’être davantage pointilleux dans leurs pratiques grâce à une charte additionnelle servant de référence à leur logo : BioBreizh, avec nombre de garanties supplémentaires concernant la qualité des produits. On ne trouve, par exemple, chez BioBreizh qu’une production locale et saisonnière. Pas de fraise en décembre ni artichaut au printemps.
Est-il indispensable de continuer à écrire « Bio » sur tout et n’importe quoi ?
Manger bio n’est pas nécessairement manger sain. Loin s’en faut. Mieux vaut une excellente huile d’olive traditionnelle qu’une huile de palme bio. Ou encore faire ses confitures soi-même avec des fruits traités, plutôt que d’acheter des confi-ceci-ou-cela bios fabriquées au fin fond de la République tchèque avec des fruits chinois. En outre, savez-vous que l’on trouve de l’eau minérale bio additionnée de gaz carbonique ? De l’eau gazeuse bio. Et oui ! Sachant que le CO2 est une émanation à effet de serre, cela fait sourire.
A l’heure où les parts de marché du bio se répartissent à hauteur de 20% pour les magasins indépendants, 40% pour la grande distribution et autant pour les enseignes spécialisées : Biocoop, Bio C’Bon, La Vie Claire…, on peut se demander si la lutte des prix entre ces dernières et les marques-distributeurs : Leclerc, Carrefour, Système U… ne va pas affaiblir les indépendants au profit de la grande distribution, si la guerre du bio « respectable » n’est pas déjà perdue, et si le combat de BioBreizh n’est pas désormais une bataille d’arrière-garde face aux mastodontes du consumérisme. Dans le fond, est-il vraiment indispensable d’écrire « bio » sur les produits concernés ? Ne vaudrait-il pas mieux écrire « merde » sur la merde ? Y compris lorsqu’elle est bio ?
Jérôme ENEZ-VRIAD
© Septembre 2019 – J.E.-V. & Bretagne Actuelle