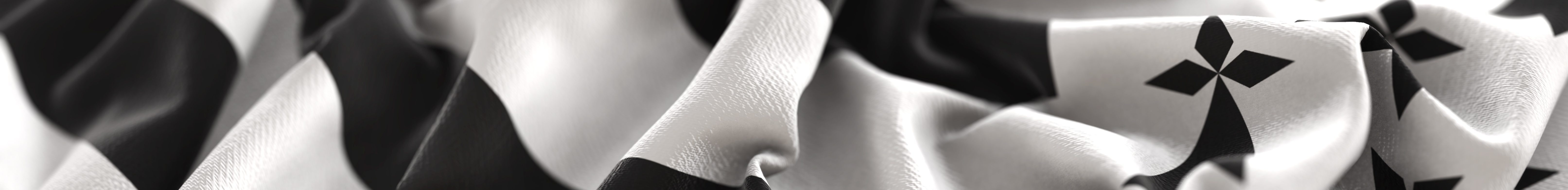J’ai connu Yves quand j’avais dix-neuf ans. C’était au temps d’Ubacs. Je me souviens de la première visite que je lui ai rendue dans ses bureaux. Deux pièces dépouillées, sobres, avec des piles de livres un peu partout, des tas de manuscrits, d’épreuves ; ce savant désordre familier à tous ceux qui l’ont connu. J’avais l’habitude de lui dire qu’il m’avait démystifié le métier d’éditeur en le désacralisant. Mais en travaillant avec lui toutes ces années, j’ai pu mesurer à quel point il lui a donné ses lettres de noblesse.
Nous avions des projets ensemble, qui n’ont pas eu le temps d’aboutir. Puis les éditions Ubacs ont cessé leur activité ; Yves a traversé une mauvaise passe et disparu de la circulation. C’est un ami commun qui en a retrouvé la trace par hasard, au détour d’une conversation dans l’arrière-boutique de chez Corre, le bouquiniste. Alors que je n’avais plus aucune nouvelle de lui depuis trois ou quatre ans, Yves a appelé un soir : “Salut, c’est Yves. J’ai envie de créer une nouvelle maison d’édition. Qu’est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as des idées de textes qu’on pourrait faire ?” Et c’est ainsi que les choses ont commencé.
En y réfléchissant, le choix des noms de ses deux maisons d’édition ne doit rien au hasard, tant ils sont à son image. Ubacs, c’est le versant plongé dans l’ombre. Et cela correspond si bien à l’humilité, la discrétion d’Yves, qui ne se mettait jamais en avant, ne tirait pas la couverture à lui. Combien savaient qu’il avait reçu le prix Gérard de Nerval à dix-neuf ans et avait eu une de ses plaquettes préfacée par Jacques Prévert en personne ? Il aurait pu en tirer une légitime fierté. Mais il avait choisi de se mettre au service de la littérature, des livres, des auteurs et du texte. Quant à la Part Commune, c’était l’idée d’échange et de partage. Quand j’ai annoncé la triste nouvelle à ceux qui, sans être des proches, le connaissaient un peu, j’ai été frappé de voir que tous me parlaient de l’éclat de son regard et de son sourire qui respiraient la bonté, la générosité.
Le premier livre que nous avons fait ensemble, c’était un texte de Charles-Louis Philippe. Il avait été bouleversé, enthousiasmé par cette écriture, par cet écrivain qui lui rappelait sans aucun doute son enfance simple. Charles-Louis Philippe avait coutume de dire : “Je me demande si quelqu’un d’autre a des amis comme j’en ai”. Je reprends cette phrase à mon compte, d’avoir connu Yves. C’est l’une des plus belles rencontres de ma vie. C’était quelqu’un de doué pour l’amitié. La nôtre était faite de tant de liens.
Il y avait d’abord ce respect, cette loyauté, cette fidélité l’un envers l’autre. Beaucoup de tendresse aussi. Cette affection qui est le propre des amitiés viriles. Une passion commune pour la littérature qui nous dévorait, nous consumait, nous animait. Nous partagions nos coups de cœur, nos enthousiasmes, nos découvertes avec la même ferveur. Il y avait aussi une complicité potache. Aussi incongru que cela puisse paraître aujourd’hui, en ce lieu, dans ces circonstances, ce qui va me manquer terriblement, ce sont nos fous rires. Enfin, nos parcours d’hommes et de pères, à quelques années d’intervalle, avaient connu les mêmes vicissitudes et cela nous avait considérablement rapprochés. Nous parlions beaucoup, entre nous, de ceux que nous aimions le plus. Votre père me parlait souvent de vous trois, Anatole, Angèle & Irène, avec tellement d’amour. Et puis, il y a eu toi, Mireille. Moi qui l’ai connu avant toi, j’ai pu voir tout ce que tu lui as apporté de meilleur depuis que tu es entrée dans sa vie.
Alors, depuis deux jours, nous sommes un peu plus pauvres et bien plus malheureux. Le monde est forcément moins beau.
Quand on m’a demandé d’écrire ou de lire quelque chose pour aujourd’hui, j’ai décidé de faire les deux. Tu te doutes, mon vieux, que je ne suis pas allé chercher bien loin pour le texte. Je suis allé directement au rayon Georges Perros. Dont tu as été l’ami, qui a tellement compté pour toi, en tant qu’homme et en tant qu’écrivain. C’est toi qui me l’as fait découvrir et c’est encore toi qui m’as accompagné la première fois à Douarnenez, en faisant quelques détours de par Quimper pour me montrer les lieux de ton enfance et de ta jeunesse. Tu te souviens aussi que quand l’un de nous n’allait pas bien, on se répétait cette phrase que Perros avait écrite quelques semaines avant de mourir : “Faut aimer la vie”. Nous savions que, sous son apparente banalité, elle était inépuisable. J’aurais aimé trouver quelque chose dans les correspondances que nous avions publiées ensemble, mais ça ne collait pas. J’avais pensé aussi à la lettre n°100 à Brice Parain, que tu aimais tant et que tu considérais comme l’un des plus beaux textes au monde. Mais ça n’allait pas non plus. Et puis, par hasard, je suis tombé sur ce passage des Papiers collés 2, qu’on aurait dit écrit pour toi. Alors, mon vieux, écoute ça :
Je vis. J’existe. Je suis là. Si je tombe, je me fais mal. On peut me faire souffrir. Je sais que je vais mourir. Que j’ai à ma charge plus pathétique que sociale, une femme et trois enfants. Je ne suis ni heureux ni malheureux. À peine si ces mots ont gardé un sens pour moi. On m’a fait. Je me suis refait. Et j’ai fait à mon tour. Je n’ai pas la sensation d’avoir commencé à vivre. C’est sans doute que je ne voudrais pas mourir. On m’appelle par mon nom, on m’envoie des lettres, je réponds. J’ai beaucoup d’amitié pour quelques êtres que le hasard m’a donné à rencontrer. À aimer. Ils m’écrivent, je leur réponds. On se voit de temps en temps […]. Je devrais être comblé. Je le suis. Ce qui m’ennuie, c’est que je vais devoir, avoir à mourir un de ces quatre matins. Ou soirs. Ça m’embête. Parce qu’on me prendra au dépourvu, que je n’aurai pas vécu. Que des siècles n’y suffiraient pas. J’ai fait à peu près tous les gestes qu’un homme normal se sent capable de faire. J’ai connu des hommes et des femmes. Tout reste à connaître. J’ai un peu voyagé. Tout reste à voir. […] Je ne réponds de rien avec autrui pour peu que je me sente fatigué. Physiquement. Le cœur qui vadrouille à droite et à gauche. La tête qui fait des nœuds. Envie de me cacher. De ne pas prendre le risque de rencontrer qui que ce soit. Pourtant j’ai besoin des autres, et de leur chaleur.
Voilà, mon vieux. D’où tu es, prends soin de nous. Merci pour toi. Je t’embrasse. Kenavo, Yves.