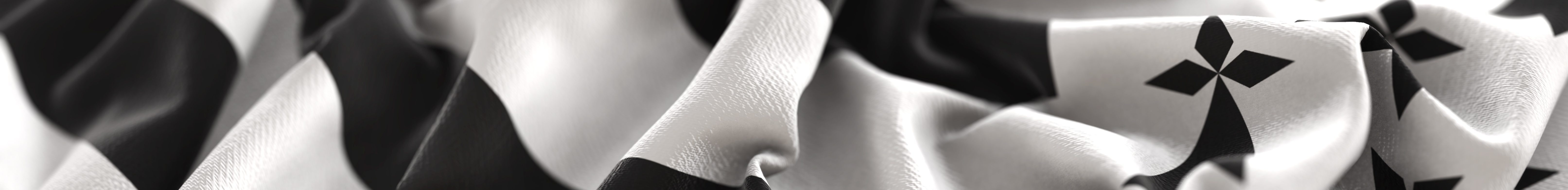Janvier 2015, pour la première fois de sa carrière, le Breton Paul Bloas apparait dans la colonne des faits divers. La marine française et la justice lui reprochent d’avoir collé ses célèbres Géants sur des navires interdits d'accès. Sujet à un simple rappel de la loi par le tribunal, l’artiste continue de faire son travail avec conviction. Le livre que lui consacrent les Editions Dialogues témoigne de son indéfectible démarche artistique, quitte à se faire taper sur les doigts.
Jérôme Enez-Vriad : Comment définiriez-vous le catalogue que vous consacre les Editions Dialogues ?
Paul Bloas : Je dirais qu’il s’agit d’une rétrospective à la manière d’un coup de projecteur sur certains épisodes essentiels de mon parcours qui n’avaient jusqu’alors pas fait l’objet de publication.
Vous êtes né à Brest, vous y vivez et y travaillez, en quoi cette ville est-elle inspirante ?
PB : Brest et Berlin sont à l’origine de mon travail. Elles ont toutes les deux été détruites à 80% pendant la guerre, puis reconstruites. Les Géants ont vu le jour en 1984, au retour d’un voyage à Berlin où j’ai séjourné part intermittence jusqu’en 1999. Les bas reliefs du Pergamon Museum [musée archéologique de Berlin] furent d’ailleurs l’un des moteurs de ma création. Depuis, Brest me sert de banc d’essai, l’espace y est beaucoup plus vaste que celui d’une mégalopole concentrée sur elle-même, d’où la taille de mes Géants.
Avez-vous pensé vivre ailleurs ?
PB : J’ai donc vécu à Berlin, également à Paris et Nantes avant de revenir sur Brest où j’ai maintenant toute ma logistique. J’aurais pu choisir New-York qui me correspond, mais l’éloignement des grandes villes pose une distance, un certain isolement loin de l’agitation et des sollicitations. Brest est à la fois un inconvénient et un avantage qui m’ont permis de travailler sur des programmes longs comme ceux de Madagascar et de La Prison. Je ne suis pas certain qu’ailleurs cela eût été possible.
Brest est donc le point fixe de votre œuvre et les autres villes son point de fuite ?
PB : Oui, mais je m’assèche à y rester trop longtemps. Le ronron quotidien m’épuise. L’errance est une nécessité car le dépaysement fragilise et il est indispensable pour ne pas s’enfermer dans le « je sais ».
Vous travaillez beaucoup la « fausse perspective », obligeant l’œil à reconstruire les formes et les proportions…
PB : Exacte. Cette définition : « fausse perspective », induit le mouvement de mon écriture qui s’affine avec le temps. Je suis toujours à la recherche de la forme essentielle. En fait, j’essaye de faire circuler l’oeil sans qu’il ne se fixe sur un point défini, pour cela je déforme les corps jusqu’à en faire les ombres de nous même.
La violence obtenue par ces flous ne renvoie-t-elle pas un peu à Francis Bacon ?
PB : C’est un compliment que vous me faites ?
Oui, mais c’est aussi une question…
PB : Et bien votre comparaison me flatte.
Trente ans après vos débuts, les graffitis sont devenus du street-art. Que vous inspire leur présence dans les musées ?
PB : Voir le marché s’en emparer pose effectivement question. Après la Nouvelle Figuration, les yeux se sont déplacés vers la rue, des journaux spécialisés se sont créés, des galeries ont suivies et aujourd’hui certaines mettent en vente des tags et des graffitis à l’encontre même de leur vocation initiale : éphémère, gratuite et populaire ?
Que souhaitez-vous exprimer par des créations toujours plus grandes au point d’avoir besoin d’échafaudages ?
PB : Mes Géants font environ 3,50 m et une simple échelle suffit (Sourire). A l’origine, je les avais imaginés vus par l’oeil d’un chien ou d’un enfant mais, avec le temps, la perspective a évolué. La déformation des caractéristiques humaines les allègent et les suspend entre ciel et terre, ce qui permet d’en souligner la fragilité. J’essaie de parler de la condition humaine par le biais d’une dramaturgie qui m’est propre.
Ces géants racontent-ils chacun une histoire ou est-ce la même ?µ
PB : Ils racontent effectivement toujours un peu la même chose, mais sur des thématiques différentes : la prison, la précarité, l’abandon… L’homme y est une quantité négligeable capable néanmoins de se rebiffer. Ils évoquent la solitude humaine dans ce maelstrom qu’est la vie.
Accepteriez-vous de les utiliser à des fins publicitaires ?
PB : Volontiers pour certaines ONG, tout dépend du but visé par l’annonceur.
Y-a-t-il une différence entre la démarche de certains street-artistes, comme par exemple Jérôme Mesnager et Miss.Tic, et votre propre travail, moins urbain mais plus « industriel » ?
PB : Je ne souhaite imposer mes Géants à personne. Pour cette raison, je les réalise sur du papier ensuite collé sur les murs, ils sont ainsi plus fragiles que s’ils y étaient directement peints. L’éphémère est un choix essentiel et indispensable à ma démarche, d’autant que l’altération de l’image au gré des intempéries ou de la griffe humaine lui permet de vivre. Du reste, par respect envers Giotto, Goya, Baselitz, Cy Twombly et bien d’autres, j’essaie de peindre sans avoir la prétention d’être peintre. Je n’utilise pas le mur comme un banal support de travail mais comme le révélateur d’une image inspirée par son emplacement. Décors et illustrations sont indissociables.
L’éphémère du street-art est-il un pied de nez à l’habitude occidentale de tout archiver dans des lieux spécifiques : bibliothèques, médiathèques, musées ?
PB : Pour une grande majorité d’artistes, c’est une façon de faire connaître leur travail sans avoir recours à l’arbitrage des galeries. Bien entendu, certains travaux ne se justifient que dans la rue (détournement de la signalétique, du mobilier et des accidents urbains…). Tout ce qui apporte une réflexion objective sur la société est intéressant.
Pourtant vous photographiez votre travail à des fins d’archivage…µ
PB : Les photographies de mes oeuvres in situ sont la seule trace pérenne de leur existence ; elles sont aussi partie intégrante du processus créatif et, mises bout à bout, font apparaître le scénario d’un ensemble.
Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment vit-on d’un art éphémère qui, pour l’essentiel, n’est pas rémunéré ?
PB : La vente des études préparatoires de mes réalisations et leurs photos sont une source de revenu. Je signe aussi des affiches et des pochettes de disques [Miossec, Noir Désir…]. Il y a également la performance Ligne de front avec Serge Teyssot-Gay [ex guitariste de Noir Désir] grâce a laquelle j’entrevois la peinture de manière différente.
Quelle est cette différence ?
PB : Dans un atelier je travaille sur une musique que je connais, contrairement à ce qui se produit avec Serge qui improvise en live pendant que je peints. C’est un dialogue entre deux créateurs et amis qui partagent les mêmes exigences. Je réponds à ses gestes musicaux, les souligne, et réciproquement. Lors de ces performances, Serge construit l’âme des Géants et moi leur coque, moyen pour le public de constater la synergie entre la peinture et la musique.
Un mot sur votre rappel à la loi par la justice…
PB : Je n’ai fait que mon travail qui est un boulot de conviction. Il était impossible d’ignorer un tel site, fut-il interdit d’accès et quitte à me faire taper sur les doigts. Sans pour autant avoir préméditer l’action en justice, le risque d’une comparution était intrinsèque au processus créatif.
Si vous aviez le dernier mot, Paul Bloas ?
Longue vie à Charlie !
Propos recueillis par Jérôme Enez-Vriad – Janvier 2015
Copyright JE-V & Bretagne Actuelle

Les Saigneurs de Paul Bloas
Livre d’art de 178 pages couleurs
Editions Dialogues
39 €