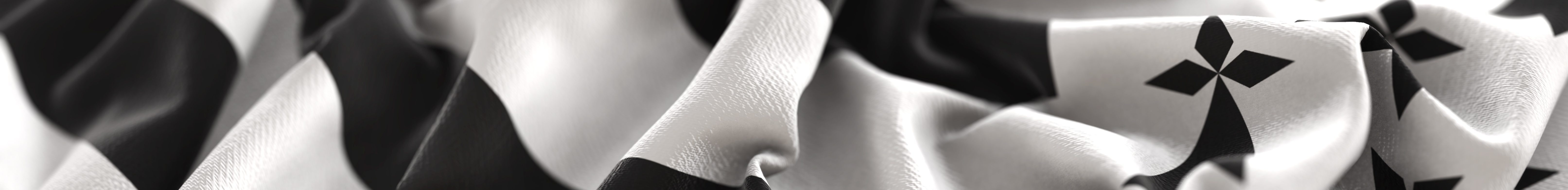Conseiller de la rédaction du mensuel Rock&Folk, journaliste, écrivain et surtout musicien, Jérôme Soligny n’est pas un dilettante qui se disperse mais bien plutôt un généraliste qui réunit musique et textes avec l’aptitude des vrais talents. Son livre, Writing on the Edge, recueille 25 ans d’interviews et chroniques autour d’une centaine d’artistes majeurs. Son dernier essai : David Bowie - Ouvre le chien, pose un nouveau regard sur la rock-star. Si l’on y ajoute l’édition poche de son roman Je suis mort il y a vingt-cinq ans, voici trois livres dernièrement parus dont l’auteur nous parle en attendant la sortie d’un nouvel album début 2016 : The Win Column.
Jérôme Enez-Vriad : Jérôme Soligny, vous êtes musicien, romancier, journaliste, connu et reconnu comme un rock critic majeur, spécialiste de l’œuvre de David Bowie, votre style s’inscrit entre celui de Philippe Manœuvre et celui, plus sophistiqué, d’Yves Adrien… Cette présentation vous convient-elle ?
Jérôme Soligny : Je n’ai pas le sentiment d’être quelqu’un de majeur sur un plan quelconque, c’est d’ailleurs l’histoire de ma carrière et je m’en arrange. Je compose des mélodies que d’autres mènent à la postérité à ma place, ce qui me va très bien car je ne suis pas fana des feux de la rampe. Pour ce qui est du journaliste, je suis incapable de situer mon style ni même d’affirmer en avoir un. Je ne vaux pas Philippe Manœuvre ou Eric Dahan. La comparaison avec Yves Adrien est flatteuse, mais c’est une figure, ce que je ne suis pas non plus.
Pareil autodénigrement ne confère-t-il pas à la coquetterie ?
JS : J’ai écrit faute de savoir refuser les sollicitations. Je suis un relayeur de passion, un mélomane à qui on a offert une tribune, et je n’ai réellement le sentiment d’être un auteur que depuis que je suis à la Table Ronde, prestigieuse maison d’édition qui semble apprécier ma plume et l’a prouvé en publiant plus de 2000 pages de mes écrits en moins de six mois : Writing On The Edge et David Bowie, Ouvre le chien.
N’est-il pas frustrant que le journaliste ait toujours masqué le musicien ?
JS : Pour mes proches, je suis un musicien qui écrit. Rock&Folk a plus de lecteurs que je ne vendrai jamais de disques. Si le courant passe avec la plupart des musiciens que je côtoie, c’est parce qu’ils me prennent pour un des leurs. Sans le musicien, il n’y aurait pas eu de Jérôme Soligny journaliste.
Vous avez toujours envisagé le rock dans une globalité culturelle, un genre musical aussi essentiel que l’impressionnisme en peinture ou l’existentialisme en littérature…
JS : Le rock est l’art majeur de ma génération. Je suis hélas ! arrivé après la bataille des mythiques 60’s, en plus d’être né du mauvais côté de la mer. (Le Havre — 1959)
Qu’y aurait-il eu de différent si vous étiez né du « bon » coté ?
JS : J’aurais chanté en anglais naturellement. C’est la langue du rock et elle aurait aussi été ma langue maternelle. Dans les années 80 et 90, être français et chanter en anglais était considéré comme une tare par les labels et les médias « gaulois ». Heureusement, AIR, puis Phoenix ont changé la donne.
Justement, AIR, Brett Anderson, David Bowie, David Gilmour, Wilko Johnson, Lou Reed… Le panthéon du rock semble vous appartenir. Quelle a été votre plus belle rencontre ?
JS : Je n’ai pas interviewé tout le panthéon du rock, loin de là. Je parle à ceux vers qui Philippe Manœuvre (rédacteur en chef de Rock&Folk) m’envoie car je suis flatté qu’il pense à moi pour le faire. J’ai également interviewé les héros de mon enfance qui le sont restés pour la plupart. A leur contact, le frisson était garanti. Croiser le verbe avec Lars Ulrich de Metallica, le discret Ryuichi Sakamoto ou Robert Fripp est chaque fois un véritable privilège.
Dernièrement, un biographe me confiait que la rencontre avec une rock star pouvait être extrêmement décevante. Selon lui, certaines ne sont intéressantes qu’à travers une œuvre relative à un égocentrisme peu flatteur…
JS : La seule rock star qui m’ait déçu en vingt-cinq ans est un guitariste mexicain qui se fait passer pour humaniste : Carlos Santana. Je ne l’ai pas mis dans Writing On The Edge sur les conseils de Philippe Manœuvre afin de ne pas m’en servir pour régler des comptes. Les artistes que je respecte se battent pour être là où ils sont. L’égocentrisme ou l’individualisme font partie de leur panoplie, de leur carapace.
Une carapace qui vous autorise malgré tout des rapports privilégiés avec plusieurs d’entre eux, et pas des moindres…
JS : Je sais ce que pensent certains de mes relations privilégiées avec quelques icônes du rock. Primo, cela n’est pas de mon fait mais du leur. Si je vais dans la loge d’Iggy Pop après les concerts, c’est parce que j’y suis invité. Le verre de vin que j’y bois, c’est lui qui me le sert. Deuzio, l’avis de personnes qui m’indiffèrent est le cadet de mes soucis. Je n’arrive même pas à les mépriser.
Pourquoi le mépris ? Ce que pensent ces gens de vous est-il à ce point vil et indigne ?
JS : Certains affichent un scepticisme dédaigneux à propos des jolies relations que j’entretiens avec plusieurs musiciens. La jalousie rend parfois méchant, c’est bien connu. Heureusement, la grande majorité des ceux qui écoutent ma musique et lisent ma prose n’est pas comme ça.
« Je n’ai jamais quitté Le Havre sur les conseils de mon ami Emmanuel de Buretel »
Vous êtes l’un des rares journalistes « parisiens » à conduire sa carrière de province. Pourquoi ce choix ?
JS : Je suis tout sauf parisien. J’ai des amis formidables à Paris, mais la mentalité qui y règne, dans le milieu du journalisme et de ce que certains croient être le rock, me répugne. Je n’ai jamais quitté Le Havre sur les conseils de mon ami Emmanuel de Buretel (Ex-président de Virgin et actuel patron de Because) car j’ai voulu voir mes enfants grandir. Ils sont, avec ma femme, le plus important de ma vie. J’ai réussi, tant bien que mal à leur offrir une vie correcte, chose que je n’aurais peut-être pas pu faire à Paris. Ce choix – les allers-retours permanents, j’ai failli mourir vingt fois sur l’A13 — m’a certainement fait louper de nombreux coches, mais je vois la mer de toutes mes fenêtres et ne peux simplement pas vivre sans elle.
Quelle mentalité reprochez-vous aux journalistes parisiens ?
JS : Je ne suis pas intermittent du spectacle, je n’ai pas carte de presse, ce qui veut dire que je ne bénéficie pas des avantages gracieusement accordés à la profession, je ne suis pas subventionné, salarié de personne et ne coûte rien à la communauté. Ce n’est pas un regret, mais un choix : ne pas être fonctionnaire de l’art. J’associe le côté rebelle du rock à ma façon de survivre dans un contexte hostile à une création artistique sans filet, celle que je pratique.
Parlons de votre livre, Je suis mort il y a vingt-cinq ans, dont l’action se déroule entre New York, Le Havre et Paris…
JS : Nous sommes au début des années 80, mais l’histoire est universelle et intemporelle. C’est un roman construit sur des faits réels. Il traite de l’amitié et de la culpabilité qui peut résulter d’une certaine indifférence causée par le tourbillon de la vie et dont la vitesse peut paraître incontrôlable lorsqu’on est jeune.
Quelle est l’influence des 80’s sur le monde actuel ?
JS : Je suis mort il y a vingt-cinq ans est un livre contre l’oubli. Les 80’s glorifiaient un matérialisme assez répugnant dont nous subissons le contrecoup aujourd’hui. La plupart des jeunes ne vivent qu’à travers des objets de marque qu’ils imaginent devoir posséder avant les autres, connectés au grand vide sidéral du Web tireur vers le bas, reflet de leur propre sous-existence. Le téléphone portable est devenu le miroir d’une jeunesse dont le misérabilisme moral n’a d’égal que l’inculture crasse et revendiquée. C’est bien sa seule forme d’arrogance.
Comment expliquez-vous que certains artistes fort talentueux ne soient pas passés à la postérité des 80’s ? Je pense à vous, mais aussi à quelqu’un comme Jay H. Alanski, par exemple.
JS : Jay, comme Stuart Moxham, Wasted Youth, David Werner ou les Fabulous Poodles, est passé à la postérité. Une autre forme de postérité. A l’ombre des grands arbres. Qui a dit que, pour être crédible, la reconnaissance devait venir du plus grand monde ? Je n’ai vendu qu’une poignée de disques mais il m’arrive aux oreilles quotidiennement que quelques-unes de mes chansons ont embelli des fragments de vie. C’est un putain d’honneur !
La préface de l’édition originale du roman est signée Kent (ex-Starshooter). Pourquoi ne figure-t-elle pas dans la version poche, au bénéfice de celle de la romancière Valérie Tuong Cuong ?
JS : Pour une raison purement contractuelle : Naïve Livres n’a pas autorisé l’utilisation de la préface de Kent par La Table Ronde. Mais je suis ravi que ces deux auteurs pour qui j’ai le plus grand respect aient eu l’occasion d’écrire quelques lignes au sujet du livre.
Sans être un roman à clefs, on y retrouve un artiste rennais devenu célèbre. Vous avez côtoyé la scène rennaise très longtemps. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
JS : Je connais mal la scène bretonne actuelle, mais je possède les deux tomes de ROK, l’anthologie de Frank Darcel (cofondateur et membre de Marquis de Sade), témoignage d’un splendide héritage. Je trouve effectivement qu’après avoir été son ambassadeur pop, Etienne Daho mène une très jolie carrière sans jamais oublier la Bretagne. Loin d’être une gloire locale au Havre ou en Normandie, je sais toutefois ce que signifie d’être attaché à sa ville ou sa région. Ma femme étant bretonne, les Côtes d’Armor sont notre seule destination de vacances depuis que je la connais et je la remercie pour ça aussi.
Y a-t-il une scène Rock au Havre ?
JS : Oui, mais je la connais mal. Pour moi, Le Havre est un décor et je n’appartiens à aucun gotha culturel. Je considère que les apparatchiks sont vulgaires et n’ont rien de chic. Ils ne m’aiment pas car ils ne savent pas par quel bout m’attraper. Je suis de la génération d’excellents groupes et musiciens havrais qui ont marqué l’héritage collectif de la ville bien plus que moi (City Kids, Fixed Up, Bad Brains, Marc Minelli, Roadrunners…), et je sais ce que la France du rock doit à Little Bob dont le parcours inspire énormément de respect.
Aujourd’hui, on compile les années 60/70/80/90 jusqu’à saturation. Pensez-vous qu’il y aura matière à faire la même chose dans 30 ans avec les années 2010 ?
JS : A mon sens, non. Mais ceux qui grandissent en écoutant la soupe actuelle auront certainement plaisir à la réécouter plus tard puisqu’ils l’associeront à leurs années de jeunesse. Bonne ou mauvaise, la musique qu’on écoute entre 11 et 25 ans marque à vie. Mais qu’on puisse comparer Lady Gaga à David Bowie est une hérésie qui me glace le sang.
« Dans les maisons de disques, des gens continuent à vivre très correctement alors que les musiciens crèvent la dalle »
L’industrie de la musique est-elle encore économiquement viable ?
JS : En tant que songwriter, le téléchargement illégal me tue, lentement mais sûrement. Dans les maisons de disques, des gens continuent à vivre très correctement alors que les musiciens crèvent la dalle ou ne survivent que grâce à l’Intermittence franco-française. Certains acteurs essaient de développer de nouveaux modèles économiques, mais qu’espèrent-ils vendre à des générations qui considèrent que la culture peut être volée, vilipendée et doit être, au bout du compte, gratuite ?
La licence globale plusieurs fois rejetée peut-elle être une solution ?
JS : Non, c’est une arnaque pour les créateurs. Tout comme les sites de streaming. Lorsqu’une de mes chansons est écoutée sur Deezer, ce que je touche se calcule en centièmes de centime. J’ai été affligé que la gauche balaie Hadopi (qui n’était certes pas la panacée) d’un revers de main.
Un talent qui vous émeut parmi la nouvelle génération ?
JS : Portugal. The Man — Un groupe de jeunes américains parmi les plus excitants de la planète pop/rock. De bons petits gars, talentueux, chaleureux et drôles en plus.
En quoi votre livre Ouvre le chien diffère-t-il des autres consacrés à David Bowie ?
JS : Aucun livre “sur” David Bowie ne ressemble à Ouvre le chien puisqu’il réunit deux conférences. Il est le seul ouvrage dans lequel la relation de Bowie avec la France est analysée en détail, notamment par son tourneur local, Alain Lahana. Je possède plus de trois cents livres sur Bowie : personne n’y raconte à ce point ses tournées de l’intérieur. Ouvre le chien propose également une liste exhaustive de ses concerts en France depuis le Golf Drouot en 1965. Il s’agit du seul ouvrage relevant de contributions directes et actuelles des proches de Bowie et de Bowie lui-même, puisqu’il a accepté de me donner en décembre 2014 son explication de la phrase “ouvre le chien”, ainsi que trois mots pour qualifier la France. Ces quelques phrases, en forme de caution, et celles qu’il m’a envoyées pour Writing On The Edge, ont été passées sous silence par la critique et une certaine presse qui n’a pour autant pas approché Bowie depuis dix ans.
Vous terminez Writing On The Edge en le remerciant, comme si votre travail de journaliste lui devait tout…
JS : Je remercie David Bowie à cause de ce que tout le monde sait et à cause de ce que presque personne ne sait, qui touche à des sujets plus graves et privés. En tant que mélomane, je dois beaucoup à une galaxie de rockers qui m’ont m’accordé de nombreuses interviews, c’est-à-dire leur confiance, et aussi à ceux qui m’ont permis d’y avoir accès, Christian Lebrun, de Best, en tête.
A cause de ce que tout le monde sait, dites-vous…
JS : David Bowie et sa musique ont été mon grand choc sensoriel, il a agi comme un révélateur et m’a enseigné très tôt l’art (car c’en est un) de savoir se tourner vers les autres et de puiser en eux et en leur œuvre de quoi se construire.
Writing On The Edge est présenté par Philippe Manœuvre comme l’ouvrage de votre vie…
JS : “… si je n’avais pas choisi d’en avoir plusieurs” précise-t-il judicieusement. Philippe sait faire dire avec astuce ce qu’il veut aux mots.
L’interview qui reste à faire ?
JS : John Lennon et Marc Bolan. Je compte bien mourir un jour, donc tout n’est pas perdu.
Si vous aviez le dernier mot, Jérôme Soligny ?
JS : Faim.
Propos recueillis par Jérôme Enez-Vriad – Avril 2015
Copyright J.E-V & Bretagne Actuelle

——
Writing on The Edge – 25 ans d’écrits Rock
1715 pages – 36,50 €
Editions La Table Ronde
David Bowie – Ouvre le chien
220 pages – 15,80 €
La Table Ronde
Je suis mort il y a vingt-cinq ans
115 pages – 7,10 €
La Petite Vermillon (La Table Ronde – Poche)
The Win Column
Sortie prévue début 2016
Verycords