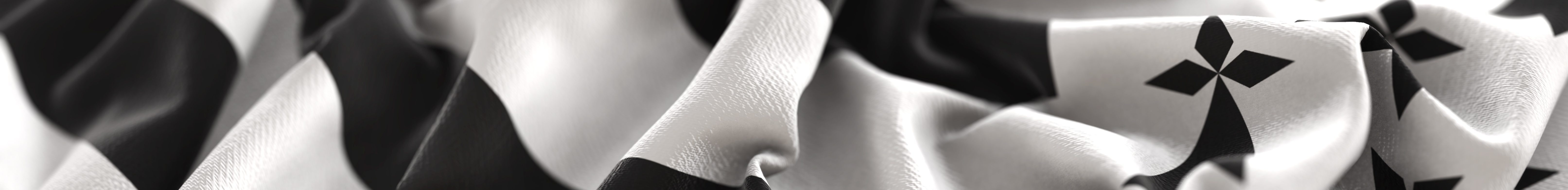Gabriel Matzneff est un personnage à part. Ce flibustier des lettres ne craint pas les tirs sous la ligne de flottaison et, malgré les abordages ennemis qui depuis cinquante ans tentent de le soumettre, il continue livre après livre d’apporter sa pierre à l’édifice d’une vie passionnée. Contradictoire mais attachant, l’auteur de Mes amours décomposées défend une morale qui lui est propre avec la courtoisie des belles éducations, manière de croquer la pomme jusqu’aux pépins avant de finir en croix. A l’occasion de la sortie du second volume de sa « correspondance électronique », Bretagne Actuelle vous propose une rencontre exclusive avec l’un des derniers « grands » de la littérature contemporaine.
 Jérôme Enez-Vriad : Gabriel Matzneff, vous êtes l’un des plus éclatants diaristes contemporain. Est-il exact que vous ne tenez plus votre journal ?
Jérôme Enez-Vriad : Gabriel Matzneff, vous êtes l’un des plus éclatants diaristes contemporain. Est-il exact que vous ne tenez plus votre journal ?
Gabriel Matzneff : Ce n’est pas exactement cela. Ce qui est aujourd’hui une œuvre achevée, c’est l’ouvrage intitulé Carnets noirs que j’ai commencé à écrire à l’âge de seize ans, l’été 1953, et dont j’ai tracé le point final le 31 décembre 2008. Ce journal intime dont le premier tome a été publié en 1976, et le dernier en 2009, porte le titre qui sera celui de l’ensemble 1953-2008, Carnets noirs. Douze tomes en sont déjà publiés, qui contiennent les années 1953-1988 et 2007-2008. Demeurent inédites dix-huit années : 1989 à 2006. Celles-ci sont déchiffrées, dactylographiées, prêtes à la publication, mais vu le nouvel ordre moral puritain et flicard qui s’est impatronisé de la planète, je ne suis pas pressé de les publier. J’attends pour cela d’être podagre et cacochyme, ou, mieux encore, d’être mort.
Ces Carnets noirs constituent une œuvre achevée, avec un début et une fin, un premier mot et un dernier. Finis coronat opus. Si vaste qu’il soit (songez aux Noces de Cana de Véronèse, aux Romains de la décadence de Couture), le peintre doit bien, un jour ou l’autre, après lui avoir donné un ultime coup de pinceau – une touche de bleu, une pointe de rouge -, considérer que le tableau est terminé, le signer, le confier à son galeriste, puis, après quelques jours de repos, installer sur son chevalet une toile vierge pour en commencer un nouveau. C’est exactement la même chose en ce qui me regarde. Carnets noirs est un livre terminé, mais je n’ai pas pour autant cessé de prendre des notes. Cela est si vrai qu’en janvier 2015 les éditions Gallimard publieront un gros volume de mes carnets intimes. Des carnets qui débutent en 2009 et couvrent les années suivantes.
Carnets noirs, c’est le journal intime d’un aventurier, d’un séducteur, d’un infatigable polisson. Un journal cavalcadant, bondissant. Celui d’après 2008 est d’un ton différent. Ma vie s’est modifiée, il est naturel que le nouveau journal où je la fixe se modifie, lui aussi. Je ne vis pas en 2014 sur un rythme aussi effréné qu’en 2004, 1994, 1984 ou 1974. J’espère cependant que la qualité de ce journal intime de vieillesse ne fléchit pas. Voilà quelques années, à Venise, j’ai vu une exposition de toiles peintes par Titien lorsqu’il était très âgé : je fus époustouflé par sa maîtrise et sa liberté sans cesse grandissantes. J’espère que ma liberté et ma maîtrise, elles aussi, vont grandissantes. Je suis moins beau, moins heureux, j’ai moins de lycéennes dans mon lit que naguère, mais si le bonheur est une puissante source d’inspiration poétique, il n’est pas la seule. En littérature, la jeunesse et la vieillesse, la maladie et la santé, la tristesse et la joie, l’espérance et le désespoir, la guerre et la paix, le soleil et la pluie, la mélancolie et la gaieté nous stimulent semblablement. Tutto fa brodo, diraient les Italiens.
Les nouveaux émiles de Gab la Rafale est la suite d’un premier volume de lettres électroniques, Les Emiles de Gab la Rafale. Ce travail n’est donc en rien la déclinaison numérique de votre journal intime ?
G.M. : Ce sont deux genres littéraires qui ne sont pas comparables. Mon journal intime, je suis seul à le lire jusqu’au jour où je décide de le publier. Une lettre, au contraire, est destinée à être aussitôt lue par son destinataire – un destinataire qui peut très bien la faire lire à d’autres personnes. Cela est vrai d’une lettre traditionnelle écrite avec papier, stylo-plume, encre, enveloppe, timbre, facteur, et l’est plus encore d’un émile (e-mail) que celui qui le reçoit peut en appuyant sur une touche faire suivre à des centaines de correspondants. L’intimité et Internet : ces deux mots jurent. Certes, pour aller dans votre sens, on peut dire que la Correspondance de Flaubert constitue une sorte de substitut du journal intime qu’il n’a jamais écrit ; mais lorsqu’un écrivain tient à la fois un journal intime et une correspondance, il est, je crois, préférable d’opérer entre les deux une nette distinction. Regardez les éditeurs de Stendhal ou de Gide : ils n’ont jamais mélangé les genres.
Dans un émile daté du 20 juillet 2013, vous écrivez : « Soudain fortifiée, corroborée, la certitude de n’être pas seul, d’appartenir à une famille esthétique, à une lignée. » Cette famille relève-t-elle d’une école d’esthètes, ou bien d’une attitude artistique en recherche de l’ultime beauté ?
G.M. : J’utilise ici l’adjectif « esthétique », mais j’aurais pu utiliser l’adjectif « spirituelle ». Je fais allusion à des écrivains, des artistes, qui m’ont précédé, dans les œuvres desquels je me reconnais, et je suis animé par la certitude que la seule famille qui compte, c’est cette famille esthétique et spirituelle, ce sont ces complices qui parfois ont vécu des siècles avant que je ne vienne au monde mais dont je me sens extraordinairement proche. Cette famille esthétique et spirituelle est infiniment plus importante que ce que la société entend d’ordinaire par « famille ». Vous savez, la « défense de la famille » chère à la droite bien pensante et autres conneries de ce genre… Lisez les Evangiles, vous verrez ce que Jésus-Christ pensait de la famille ! Il s’en fichait comme de sa première barboteuse. Sa seule famille, c’était ses disciples. Papa, maman, c’était fort secondaire. D’ailleurs, dès l’âge de douze ans, il fugue. Moi, j’ai fugué toute ma vie et m’en porte très bien.
Dans Maîtres et complices, vous évoquez le père de Schopenhauer baptisant son fils Arthur, parce que ce prénom s’écrit de la même façon dans de nombreuses langues européennes. C’est aussi le cas de Gabriel. Comment un prénom influence-t-il une vie ?
G.M. : Là, mon cher, vous me posez une colle. Je n’en ai pas la moindre idée et je n’ai pas, en outre, le sentiment que mon prénom ait influencé ma vie. Ce qui est exact, c’est qu’il est plus agréable de porter un joli prénom – c’est mon cas – qu’un vilain. Je vous parlais des lycéennes qui ont peuplé ma vie et m’ont inspiré mes meilleurs romans, mes plus beaux poèmes. Peut-être mes yeux bleus ne furent-ils pas l’unique raison de mon succès auprès d’elles. Peut-être mon prénom archangélique y est-il, lui aussi, pour quelque chose. Cela dit, et pour parler sérieusement, l’archange Gabriel, outre à avoir un prénom dont la musique charme les oreilles, est un saint patron extrêmement efficace. Il l’a prouvé le jour de l’Annonciation. Ce Mercure chrétien est le messager des bonnes nouvelles. Il m’a souvent tiré d’affaire. Je ne le prie jamais en vain.
Schopenhauer est présent dans presque tous vos textes. Pourquoi cette préséance sur vos autres inspirateurs ?
G.M. : Schopenhauer n’est guère présent dans mes romans et mes poèmes ! En revanche, vous avez raison, il est très présent dans mes essais. J’ai même dédié l’un d’eux, Le Taureau de Phalaris, « aux mânes de Schopenhauer ». Parmi les philosophes modernes, il est en effet celui dont je me sens le plus proche. Si je n’avais le droit d’emporter qu’un livre sur une île déserte, ce serait Le Monde comme volonté et comme représentation. Cela dit, le seul de mes aînés à qui je consacre un livre entier n’est pas un philosophe, mais un poète : Byron, né, soit dit par parenthèse, la même année que Schopenhauer, en 1788.
Nietzsche aussi fait partie de vos récurrences. Vous le citez régulièrement à propos de la morale aristocratique…
G.M. : C’est Schopenhauer qui lui a enseigné la morale aristocratique. Souvenez-vous la page de Parerga e Paralipomena où Schopenhauer exprime le désir de voir renaître « une véritable bonne société, dans la forme où, sans doute, elle a existé à Athènes, à Corinthe et à Rome ». D’une manière générale, tout ce qu’a écrit, pensé Nietzsche a déjà été formulé par Schopenhauer. Nietzsche en était conscient. Dans Maîtres et complices, je cite ce qu’il écrit le 28 septembre 1869 à son ami le baron de Gersdorff : « Wagner est tout pénétré de la philosophie de Schopenhauer, et entièrement sanctifié par elle ; quant à moi, cette conception du monde est celle qui a le plus d’affinités avec ma personnalité intime et de jour en jour pénètre davantage ma pensée. »
Nietzsche est plus lu que Schopenhauer parce qu’il est plus facile à lire, surtout lorsqu’on a dix-sept ans. Le Monde comme volonté et comme représentation est un gros morceau dans lequel il faut oser plonger, c’est la traversée de la Manche à la nage. En revanche, les petits pamphlets de Nietzsche, l’Antéchrist, Ecce homo, Le Crépuscule des idoles, sont d’une lecture aisée, ça se lit à la plage ou au jardin du Luxembourg. Même des essais tels qu’Aurore ou Humain, trop humain, écrits, à la manière de Chamfort et de La Rochefoucauld, sous forme d’aphorismes, sont plus faciles à lire que les longs chapitres qui composent Parerga e Paralipomena. C’est si vrai que pour faire lire Parerga e Paralipomena, les éditeurs se permettent de découper ce gros ouvrage en tranches, tel un saucisson. Ils isolent un chapitre et le présentent, privé de son contexte, comme s’il s’agissait d’un livre entier. Cela part d’un bon sentiment, je n’en doute pas, mais témoigne, inconsciemment, d’un manque de respect envers l’œuvre. Un livre forme un tout.
Quand j’avais dix-sept ans, les livres de Schopenhauer et de Nietzsche n’étaient pas réédités, ils n’existaient que d’occasion, dans de vieilles et introuvables éditions du dix-neuvième siècle. Ces deux auteurs sentaient le soufre et lorsque je les citais dans mes dissert de philo, le professeur barrait leurs noms avec un crayon rouge, ajoutant, furieux, dans la marge : « Vous feriez mieux de lire Descartes et Bergson ! » J’ai dû attendre un an avant que le vieux monsieur Vrin, dans sa librairie de la place de la Sorbonne, me déniche un exemplaire d’Aurore dans la traduction d’Henri Albert au Mercure de France. Aujourd’hui, devenus à la mode, leurs livres figurent dans les collections de poche, se vendent partout, mais je les préférais l’époque où leurs rares lecteurs formaient une sorte de société secrète, où, en les aimant, en les lisant quasi en cachette, nous nous sentions des conspirateurs, des carbonari.
A propos de moral, j’aimerais comprendre ce qui vous a amené à soutenir Ferdinand Marcos au moment de sa chute, puis, quelques années plus tard, le colonel Kadhafi et, plus récemment, Bachar-el-Assad.
G.M. : Que tous les politiciens ne soient pas des hommes d’Etat est une évidence. Prenez, par exemple, la Cinquième République française : Charles de Gaulle et François Hollande y ont été élus aux mêmes fonctions, mais De Gaulle est un des plus grands hommes d’Etat que le monde ait eus au vingtième siècle, au lieu que M. Hollande a juste les qualités requises pour être sous-préfet de Corrèze.
Ferdinand Marcos avait des qualités d’homme d’Etat que n’avait pas la marionnette Cory Aquino que les Américains mirent à sa place. S’il en avait eu le loisir, Marcos aurait mené à bien cette réforme agraire que, près de trente ans après sa chute, l’infortuné peuple philippin attend encore. En outre, quand il a été renversé par les Américains, enlevé de force dans le palais présidentiel par des parachutistes yankees, arraché à son bien-aimé pays, le président Marcos avait depuis longtemps aboli la loi martiale : les Philippins étaient un peuple libre et la violence avec laquelle les journaux attaquaient, critiquaient chaque matin le chef de l’Etat en était une preuve spectaculaire.
Quant à la Libye et à la Syrie, la politique qu’y ont menée, qu’y mènent les Etats-Unis et leurs alliés (dont, hélas, la France) est une honte. Le seul vrai dictateur qui existe sur la planète est l’impérialisme américain, et les criminels de guerre que devrait juger, et condamner, le tribunal de La Haye, ce sont les horribles Bush, père et fils.
Une œuvre ne se construit-elle pas sur une volonté de fer digne d’un système totalisant et totalitaire ?
G.M. : Pour créer une œuvre, qu’il s’agisse d’un roman, d’un tableau, d’une symphonie, d’une sculpture, d’un film, il faut en effet beaucoup de détermination, de volonté, de travail. A l’époque de la Renaissance il y avait un pape – j’ai oublié son nom – qui enfermait à clef les peintres auxquels il avait confié une tâche, pour les obliger à s’y consacrer, les empêcher de courir le guilledou. Aucun pape ne m’enfermant à clef, je suis obligé de trouver en moi-même la force de résister à l’envie de paresser, la force d’oublier le soleil qui brille dehors et de rester enfermé tête-à-tête avec mon manuscrit. Lorsqu’on aime la vie comme je l’aime, ce n’est pas toujours facile. Les tentations d’échapper à son travail, de prendre la poudre d’escampette sont nombreuses.
Les titres de vos livres sont toujours soignés, très beaux : Comme le feu mêlé d’aromates, Cette camisole de flammes, L’Archange aux pieds fourchus, Les Lèvres menteuses… Vous êtes l’un des rares auteurs à mesurer l’importance du nom pour une œuvre…
G.M. : Vous oubliez le plus beau de tous, celui du roman que certains tiennent pour le livre le plus considérable qui soit sorti de ma plume : Ivre du vin perdu.
Comme Proust (proustien), Duras (durassien), Sagan (saganesque), un adjectif procède désormais de votre nom : on évoque un style ou un académisme matznévien, une obsession ou une fluidité matznévienne. Pour un écrivain, avoir son nom adjectivé n’est-il pas la glorieuse d’un peintre à qui l’on construit un musée de son vivant ?
G.M. : En France, pour un écrivain, le musée de son vivant, c’est la collection de la Pléiade chez Gallimard. Par ailleurs, je suis le contraire d’un auteur académique. Un auteur académique n’aurait, ni en ce qui touche la forme ni en ce qui regarde le fond, écrit un roman tel que Isaïe réjouis-toi, un essai tel que Les Moins de seize ans. Quant à l’adjectif que vous évoquez, je dirais de lui ce qu’Aramis dit dans Vingt ans après du projet qu’il a de se battre en duel avec un duc : « Un duel avec un Châtillon ? C’est flatteur. » L’adjectif « matznévien », lui aussi, est flatteur. Si mes souvenirs sont bons, c’est le professeur Georges Molinié, célèbre philologue, qui aime mes livres et les fait en Sorbonne étudier à ses élèves, qui l’a inventé. Depuis, ce « matznévien » a fait florès.
Parmi les terreaux de votre œuvre, se trouvent l’orthodoxie chrétienne et vos maîtres à penser. On a envie de savoir comment concilier le rigorisme de la première avec le sulfure de Casanova, de Byron, de Montherlant, mais aussi de Chestov et tous les autres…
G.M. : L’unique terreau de mon œuvre, ce sont mes passions, ma sensibilité, mes révoltes, mes amours, mes plaisirs, mes douleurs. Quant aux contradictions que vous évoquez, à moins d’être une bûche, tout homme les éprouve. La différence entre un homme ordinaire et un artiste est que celui-là garde ses contradictions cachées dans son cœur, elles sont muettes, au lieu que l’artiste, lui, les exprime dans son œuvre où elles apparaissent au grand jour. Tout être intelligent est agité d’élans contradictoires, et de saint Augustin à Verlaine, de Sénèque à Dostoïevski, ou, pour reprendre les noms que vous citez, de Casanova à Montherlant, connaissez-vous un seul écrivain qui n’observe en soi-même le combat de l’ange et de la bête, de la Madone et de Sodome, de la débauche et de la maîtrise de soi ? Ce combat existe, et il est nécessaire. Sans lui, personne n’écrirait.
La société a cousu mille étoiles jaunes, roses et multicolores sur votre casaque d’écrivain, mais aussi sur vos vêtements de tous les jours. En revanche, personne ne vous a jamais reproché de mal écrire et, ces dernières années, moult gentillesses et courtoisies fleurissent à propos de votre œuvre. Comment vit-on une objectivité si tardive ?
G.M. : Durant les vingt premières années de ma vie d’écrivain, mes livres furent jugés sur leurs qualités littéraires, leur style, l’intérêt du monde que j’y décris, la psychologie de mes personnages, la pertinence de ma pensée, etc. Ce fut plus tard que les choses se gâtèrent, lorsque les pharisiens et les quakeresses prirent le pouvoir et se mirent à juger les œuvres d’art, en particulier les livres, selon leur degré de moralité ou d’immoralité. J’ai alors traversé une période difficile : épinglé « immoraliste », j’étais devenu un pestiféré. Tout ce que je pense de la question, et la façon dont je l’ai vécue, c’est dans un roman publié en l’an 2000, Mamma, li Turchi !, que je l’exprime. A l’encontre de ce que l’on croit souvent, un auteur se livre autant dans ses romans que dans son journal intime, et parfois davantage, car la transposition romanesque est pour lui un surcroît de liberté. Aujourd’hui, ma situation s’améliore-t-elle ? Suis-je jugé avec plus d’objectivité ? Vous semblez le croire. Ma foi, c’est possible, mais je n’en suis pas convaincu. J’ai le sentiment que jusqu’à mon dernier soupir je resterai un franc-tireur, un type qui nage à contre-courant. En 2013, lorsque Séraphin, c’est la fin ! obtint le prix Renaudot, on aurait pu s’attendre à ce que tous les amoureux de la langue française se réjouissent qu’un écrivain tel que moi soit enfin couronné par un important jury, mais non, il n’en a pas été ainsi, et de misérables sycophantes firent circuler sur Internet une pétition scandalisée, exigeant qu’on me retirât le prix ; il se trouva même des déchets humains, d’anonymes déchets humains, pour la signer. Inutile de vous dire que les membres du jury Renaudot accueillirent cette dégueulasserie avec un haussement d’épaules, et moi itou.
Avoir dû faire sa place (malgré soi) à l’écart de tous, n’est-il pas le plus grand service que vous ait rendu l’intelligentsia ?
G.M. : Vous avez mille fois raison ! C’est la maxime n° 8 de Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles : « Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort ». L’ostracisme dont je suis l’objet (aujourd’hui encore, il y a des journaux qui ne parlent pas de mes livres, des chaînes de télévision et de radio où je ne suis jamais invité) pourrait détruire une âme tendre qui, pour avoir le sentiment d’exister, a besoin d’être aimée, encensée, qui ne supporterait pas qu’on lui collât sur le front l’étoile jaune de M le Maudit. Moi, c’est le contraire : j’ai appris très tôt à être supérieur à l’approbation, et ma réputation d’écrivain sulfureux, d’infréquentable Belzébuth, non seulement ne me fait ni chaud ni froid, mais elle me fortifie dans mon plaisir à être moi-même. C’est la phrase du tzar Ivan dans le film d’Eisenstein : « Ah ! Ils m’appellent Ivan le Terrible ? Eh bien, je vais leur donner satisfaction, je vais être terrible, boudou grozni… »
Extrait de Cette camisole de flammes, nous sommes en 1959, je vous cite : « Devenir soi-même, il n’y a pas pour le libre esprit de plus grand impératif. Mais que d’embûches sur la route ! Ce n’est que par une résistance féroce à la pression sociale que nous pouvons atteindre au but. Encore faut-il beaucoup de chance. » Quelle a été votre part de résistance et comment l’avez-vous conciliée avec la chance ?
G.M. : 1959, l’année où j’ai écrit en Algérie mon essai sur le suicide chez les Romains, commencé à prendre des notes pour mon premier roman, l’Archimandrite ; où, résiliant mon sursis d’incorporation, je suis parti faire mon service militaire, est une année décisive à bien des égards. J’étais très jeune alors, j’avais une vive conscience des obstacles que j’aurais à surmonter, mais j’en avais une autre, non moins vive, de ce que je ne voulais pas être, de ce que la société des adultes ne réussirait jamais à m’imposer. Bref, la liberté ou la mort. Cependant, la détermination ne suffit pas, et vous avez raison de souligner l’importance de la chance. J’ai toujours eu dans ma vie beaucoup de chance, je suis né coiffé et les choses se sont organisées sans que j’aie beaucoup d’efforts à faire. Je suis le contraire d’un arriviste, d’un carriériste et j’aurais été, je crois, incapable de frapper à des portes, de quémander, de solliciter. Grâce à Dieu (et à l’archange Gabriel, sans aucun doute), je n’ai pas eu à le faire : ce sont les éditeurs et les directeurs de gazettes qui sont venus à moi, non l’inverse, et j’ai eu la chance de toujours pouvoir travailler à mon rythme, n’écrivant que ce que j’avais envie d’écrire, ce qui me venait du cœur, du cerveau, des tripes ; bref, j’ai eu, j’ai l’extraordinaire privilège de mener la vie d’homme libre qu’adolescent je rêvais d’avoir et, dans l’ordre artistique, de faire mon œuvre.
Cet entretien a lieu en période de carême pascal. Le propre du chrétien est de pardonner. Absolvez-vous ceux qui vous ont jeté aux lions et vous maudissent encore ?
G.M. : On avait jadis posé la question à François Mauriac, et je ferai mienne sa réponse car elle me plait beaucoup : « Pardonner ? Oui, assurément, je pardonne… Mais je n’oublie pas les dates. » D’autre part, si je tâche d’être un bon chrétien, je suis aussi un fidèle sectateur de la déesse Némésis. Cette déesse, qui a un faible pour moi, est toujours prompte à me venger, et d’ordinaire les gens qui médisent de moi, cabalent contre moi, sont vite précipités dans les plus noires infortunes. Je fais mienne la réponse de Mauriac et je fais également mienne la célèbre prière de Byron à Némésis au quatrième chant de Childe Harold : « Et toi, qui n’a jamais laissé impunies les injustices humaines, puissante Némésis !… » Protégé par l’archange Gabriel, je le suis aussi par la déesse de la vengeance, qu’on se le dise.
Si vous aviez le dernier mot, Gabriel Matzneff ?
G.M : Si j’avais le dernier mot, je l’utiliserais pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à mon travail ; pour remercier les jeunes gens, filles et garçons, qui m’écrivent que la découverte de mes livres a changé le cours de leur vie. En ce qui regarde les filles, mes plus grandes amours ne furent, certes, pas toutes des lectrices. Cependant, si tant de filles qui avaient l’âge d’être mes filles, puis mes petites-filles, eurent le désir de me connaître, puis vécurent avec moi de passionnées amours, c’est à mes livres que je le dois. Voilà qui, à mes yeux, suffit à me justifier de les avoir écrits et publiés.
Propos recueillis par Jérôme ENEZ-VRIAD
Gabriel Matzneff – Carême pascal 2014
Publications de Gabriel Matzneff
Journaux Intimes
Cette camisole de flammes [1953-62] (1976)
Vénus et Junon [1965-69] (1979)
L’archange aux pieds fourchus [1963-64] (1983)
Un galop d’enfer [1977-78] (1985)
Mes amours décomposés [1983-84] (1990)
Elie et Phaéton [1970-73] (1991)
La prunelle de mes yeux [1986-87] (1993)
La passion Francesca [1974-76] (1998)
Les Soleils révolus [1979-82] (2001)
Calamity Gab [1985-86] (2004)
Les Demoiselles du Taranne [1988] (2007)
Carnets noirs [2007-08] (2009)
Récits
Comme le feu mêlé d’aromates (1969)
Le Carnet arabe (1971)
Boulevard Saint-Germain (1998)
Monsieur le comte monte en ballon (2012)
Romans
L’Archimandrite (1966)
Nous n’irons plus au Luxembourg (1972)
Isaïe réjouis-toi (1974)
Ivre du vin perdu (1981)
Harrison Plaza (1988)
Les Lèvres menteuses (1992)
Mamma, Li Turchi ! (2000)
Voici venir le Fiancé (2006)
Essais
Le Défi (1965)
La Caracole (1969)
Les Moins de seize ans (1974)
Les Passions schismatiques (1977)
La Diététique de Lord Byron (1984)
Le Sabre de Didi (1986)
Le Taureau de Phalaris (1987)
Maîtres et Complices (1994)
Le Dîner des mousquetaires (1995)
De la rupture (1997)
C’est la gloire, Pierre-François ! (2002)
Yogourt et Yoga (2004)
Vous avez dit métèque ? (2008)
La Séquence de l’énergumène (2012)
Séraphin, c’est la fin! (2013)
Poésies
Douze poèmes pour Francesca (1977)
Super flumina Babylonis (2000)
Courriers Electroniques
Les Emiles de Gab la Rafale (2010)
Les nouveaux Emiles de Gab la Rafale (2014)