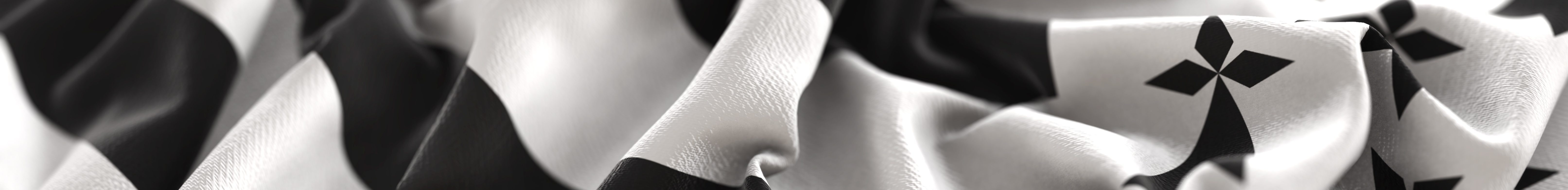Originaire de Rostrenen dans les Côtes d’Armor, Christophe Honoré est un réalisateur attentif et exigeant. L'ex-critique acerbe des cahiers du Cinéma passé depuis derrière la caméra, s’est aussi fait remarqué en tant qu’auteur de romans pour enfants et adolescents. Des livres dans lesquels il aborde les thèmes réputés difficiles du suicide, du sida, du mensonge des adultes, de l'inceste ou des secrets de famille. En 12 ans, le cinéaste breton a déjà réalisé huit long-métrages dont Les Chansons d'amour (2007) Non ma fille tu n'iras pas danser (2009) ou Les Bien-Aimés (2011). Le dernier en date, Les Malheurs de Sophie, tiré de l’œuvre de la Comtesse de Ségur a réuni en 2015 à l’écran, Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani et Muriel Robin. Rencontre avec un réalisateur au cinéma chevillé au cœur…
 Comment est née votre vocation de réalisateur ?
Comment est née votre vocation de réalisateur ?
En fait, cela m’est tombé très tôt en 6e, 5e au collège Edouard Herriot de Rostrenen. Je participais au journal de la classe. Quand je commençais à dire aux gens que je voulais être cinéaste, ils me regardaient et se disaient « pauvre garçon». Aujourd’hui, j’en rigole, mais je n’arrive pas à comprendre comment j’ai réussi à concrétiser ce désir d’adolescent. C’était un peu un scandale social de réussir à faire ce métier-là en venant de ce milieu-là. De plus, je suis resté assez tardivement en Bretagne. Quand, je suis arrivé à Paris en 1996, j’avais 26 ans et je me disais que tout était déjà un peu joué. Et puis je ne connaissais personne. Je passe d’ailleurs aujourd’hui pour un cinéaste bobo parisien, ce qui m’a toujours amusé. Cela vient certainement du fait que j’ai travaillé avec des acteurs, plutôt rive-gauche comme Louis Garrel ou Chiara Mastroianni…
Comment se passe l’écriture de vos scénarios ?
J’ai toujours aimé écrire des scénarios, sans doute parce que j’étais écrivain auparavant. Je vis un peu cela comme une récréation. C’est vraiment le moment où l’on épuise tous les possibles d’une histoire. Je fais partie de ces réalisateurs qui écrivent des scénarios, parce qu’il faut les écrire, mais qui au moment du tournage font un autre film. Il n’y a rien de plus terrible pour moi qu’une journée de travail où on a fait tout ce qui était prévu. J’aime beaucoup écrire pour les autres car je n’ai aucun sentiment d’égo. J’ai aidé par exemple Louis Garrel à écrire son scénario. Louis étant acteur, cela s’est étalé sur trois ans. Je n’ai pas cessé de lui fournir du bois. J’apprécie cette façon de faire. L’écriture peut être considérée comme un travail solitaire, mais paradoxalement, vous êtes très perméable au monde. Une conversation que vous allez entendre dans un bus, vous allez l’intégrer dans le texte. Je me sens beaucoup plus seul sur un plateau de cinéma que lorsque j’écris.
Quel genre de réalisateur êtes-vous ?
Sur un plateau de cinéma, j’ai une idée fixe et je passe la journée à essayer de faire en sorte que les autres ne m’obligent pas y renoncer. Je ne supporte pas que les acteurs une fois maquillés retournent dans les loges. J’essaye toujours d’enchainer au maximum. C’est cela qui me donne de l’énergie. Je suis assez délicat avec les acteurs, beaucoup moins avec les techniciens. On dit souvent que les acteurs sont parfois trop payés, mais imaginez que pendant 6 ou 7 semaines vous vous laissiez regarder dans des situations que vous n’avez pas choisies. C’est d’une impudeur extrême. En tant que metteur en scène, nous sommes obligés de transformer cette obscénité en poésie. Toutes les émotions fortes que dans la vie on a envie de garder pour soi sont publiques et rejouées à l’infini. Il faut être très entouré par ses proches pour résister à cela. En revanche, le metteur en scène qui prend le pouvoir sur les acteurs, ne m’a jamais fait rire. Vous vous souvenez certainement de la polémique qu’il y a pu avoir avec Léa Seydoux sur « La Vie d’Adèle ». En gros le réalisateur (Abdellatif Kechiche ndlr) l’a choisie en disant qu’il ne voulait pas d’elle. Pour moi, quand la question du pouvoir est au cœur du rapport avec les acteurs, je trouve cela insupportable. Je pense que cela détruit beaucoup de films français. J’ai d’ailleurs l’impression que beaucoup de cinéastes en France n’aiment pas assez les acteurs. La grande force du cinéma américain, c’est que l’on sent que les acteurs sont rois. Quoi qu’il se passe, c’est eux qui dirigent le film.
Que retirez-vous de vos années de jeunesse en Bretagne?
Je suis reconnaissant à la Bretagne de m’avoir fait vivre une enfance assez ennuyeuse. Cet ennui relatif m’a permis de rêver et de cultiver mon imaginaire. Le cinéma passait forcément pour moi par Paris ou les grandes capitales mondiales. Je vivais presque cette implantation en Bretagne comme une malédiction. Et puis quand j’ai commencé à faire des films et à écrire des livres, je me suis aperçu que la Bretagne était un vaste terrain d’investigation. Tous mes romans pour la jeunesse se passent d’ailleurs là-bas. Dans mon premier livre pour enfant, j’avais inventé une fausse ville qui s’appelait Nostrenen au lieu de Rostrenen. Je disais que Nostrenen était au cœur du napperon que représentait pour moi la Bretagne. Tout le monde trouvait les bords (les côtes) très jolis, plein de dentelle alors que le centre n’était pas très beau, tout serré. Mais je disais aussi que c’était grâce au centre que tout tenait.
Y a-t-il une ou des personnalités que vous admirez particulièrement en Bretagne ?
Certainement Anatole Le Braz qui dans La Légende de la mort s’intéresse aux esprits et aux prémonitions. Son œuvre m’a beaucoup influencée lorsque j’écrivais des livres pour enfants. L’autre personnalité bretonne qui m’a également marquée, c’est bien sûr le cinéaste Alain Resnais. Quand on l’évoque, on pense tout de suite au Morbihan, à « Mon oncle d’Amérique ». Chez Resnais le thème de la mort et de ce qu’il y a après la vie demeure omniprésent. Cela vient de son ancrage breton.
Etes-vous un cinéaste, Breton, Français, du monde ?
Nous avons parfois intérêt à ne pas trop être trop étiquetés cinéastes français. Mais de là, à être considéré comme cinéaste breton, c’est encore autre chose. En même temps, nous voyons bien que ce qui peut rendre la mondialisation humaine, c’est justement les échanges entre les régions. Les régions ont tout à gagner à s’affranchir progressivement du système jacobin et à exister par elles-mêmes. J’ai par exemple accepté d’être artiste associé au théâtre de Lorient. Et c’est depuis Lorient que j’ai monté tous mes spectacles vivants avant qu’ils ne soient présentés à Paris. Il ne s’agit pas pour moi d’être l’ambassadeur d’une région. C’est juste qu’à un moment, c’est le territoire que je connais le mieux, parce qu’il fait partie de ma vie, que j’y vais tous les ans en vacances et que j’y ai des amis et de la famille. Dans un sens, je le connais peut-être mieux que le territoire parisien. Mais il faut bien reconnaitre que c’est pratiquement impossible de faire du cinéma depuis la Bretagne. En dehors de quelques initiatives à Rennes ou à Nantes, le cinéma se passe encore presque exclusivement à Paris.
Il y a de plus en plus de tournages en Bretagne, mais est-ce pour autant une région de cinéma ?
La Bretagne n’est pas une région très cinéphile. Le nombre d’entrées, notamment dans les villes universitaires, est par exemple beaucoup moins important qu’à Aix en Provence. Il faut avouer que l’exploitation en Bretagne est complexe. Il y a plein de petits cinémas gérés par des associations qui se font manger par les gros systèmes d’exploitation. Seules les villes de Dinard avec son festival du film britannique, Douarnenez (Gouel ar filmou) ou Brest (festival du court-métrage) développent des événements importants autour du 7e art. Ce sont des festivals tout à fait honorables, mais qui ont gardé une forme relativement modeste, alors que nous avons un parc hôtelier tout à fait adapté par rapport à Deauville, la Rochelle, Cannes ou Lyon qui accueillent de grands rendez-vous cinématographiques. Cela pourrait d’ailleurs être une bonne idée de réinventer un grand festival de cinéma breton.
Vous avez tourné un téléfilm en Bretagne intitulé « Non ma fille tu n’iras pas danser » et puis plus rien, pour quelle raison ?
En fait, c’est compliqué de revenir en Bretagne et de filmer des endroits qui sont très proches de vous et dont vous gardez un souvenir très précis. Je tournais autour du lac de Guerlédan. C’était le lieu de mes promenades dominicales et je ne retrouvais pas les paysages que j’avais en mémoire. La Bretagne est une région qui offre de somptueux décors naturels, mais qui paradoxalement dans ses structures de production, est beaucoup moins rompue aux techniques d’aide au financement que les régions Centre ou Rhône Alpes.
Quelle expérience tirez-vous du tournage de votre dernier film « Les Malheurs de Sophie » ?
Mon dernier film s’est attaché à l’adaptation de l’œuvre écrite au 19e siècle par la Comtesse de Ségur. Je tenais beaucoup à ce que Sophie ait l’âge qu’elle a dans le livre. J’ai donc travaillé avec une actrice principale qui avait 5 ans, ce qui est très particulier. Pour moi, c’était un peu nouveau parce que c’était un film en costume. J’ai toujours été très méfiant par rapport à ce genre de film, bêtement d’ailleurs. Avec l’idée un peu naïve que les films en costumes avait un peu un côté musée de cire. Je me suis aperçu que cela était faux, en tout cas dans ce projet-là.
Propos recueillis par David RAYNAL